Lire ici

Antoine Carrot :
quelques poèmes
 Au printemps de 1989, j'ai reçu et publié (parce que j'avais aimé qu' « une syntaxe d'automne cherche ses mots fanés ») dans le numéro 33 de Texture un poème d'Antoine Carrot.
Au printemps de 1989, j'ai reçu et publié (parce que j'avais aimé qu' « une syntaxe d'automne cherche ses mots fanés ») dans le numéro 33 de Texture un poème d'Antoine Carrot.
Celui-ci est décédé en 1996, mais sa fille Guylaine Carrot vient de m'envoyer « Dans l'illusion de l'aube », un recueil posthume qu'elle a fait paraître récemment aux Cahiers Bleus, éditions Zurfluh. Elle m'a également adressé quelques inédits, car il reste de nombreux recueils d'Antoine Carrot en attente de publication : Les quatre mains du vent, L'arbre nu, Saisons grises, Les équinoxes de l'homme, Mes chants de préférences, Dans l'illusion de l'aube, etc...
J'ai lu, aimé, et effectué un choix, que je vous donne à lire ci-dessous.
Qui était Antoine Carrot ?
Expert-comptable, Antoine Carrot vivait dans le Beaujolais. Il avait publié tôt (premier recueil en 1946) , mais était resté silencieux de 1950 à 1976.
« Ce bon vivant n'est jamais loin du désenchantement, ce nostalgique pose sans cesse ses regards sur l'aube nouvelle, ce silencieux ne cesse d'appeler les mots à son secours. Mais contradictions ou alternances ne sauraient être fardeaux, même si "l'âme pèse lourd" dans ses incertitudes, elles sont essentielles paradoxalement pour nourrir une simplicité qui est la clé même de sa prodigalité poétique », écrit à son sujet Marie Ange Sébasti, qui a préfacé nombre de ses livres.
Premiers matins, 1946
L'arbre seul, 1976
Des croix sur les murs, dessin de Nicole Spay, Les poètes de Laudes, 1987
Qu'en toi demeure, illustration de Paul Siché, Gerbert, 1995
L'ourisse suivi de Villages, illustration de Daniel Chantereau, La Bartavelle, 1996
Les Silencieuses, illustration de Paul Siché, La Bartavelle, 2002
Le fil du chemin, illustration de Paul Siché, Aléas, 2003
Chemins de sel, illustration de Dominique Daguet, Cahiers bleus, 2004
Soir d'hiver, gravure de Bernadette Planchenault, Empreintes, 2004.
Nocturne, préface d'Anne Lise Blanchard, Librairie-galerie Racine, 2005
Quatre mains du vent, préface Alain Wexler, illustration Jean-Christophe Schmitt, Jacques André éditeur, 2007
Dans l'illusion de l'aube, préface de Dominique Daguet, Cahiers bleus, 2008.
Antoine Carrot a publié ses poèmes dans de nombreuses revues : Plein Chant, Cahiers Froissart, Laudes, Lieux d'être, Texture, Noréal, Jalons, Soleil des loups, Coup de soleil, A contre silence, Artère, Verso, La vie, Dossiers d'Aquitaine, Rétroviseur, ARPA, Friches, Cahiers de Poésie, Le nouveau gong, Passage, Cri d'os, Lefoudulire international (n° spécial France-Hollande) Belgique : Spantole, Regart, Marginales.
D'autres infos sur le site de Guylaine Carrot : http://www.guylaine-carrot.com
Certaines envergures me submergent.
Le poing ne frappe que l'apparence des pierres
les croix tracées dans le retardement
des longues insomnies de la nuit
cachent les grincements des volets que l'on ferme.
Une odeur persiste d'où dépend la nostalgie
L'instant est fait d'autres instants soigneusement préservés
Où l'abeille a son miel pour principale offense.
Ce n'est pas prouvé
Mais des feux brûlent sur la colline imaginaire
il faut le savoir puis secouer la cendre
devenir la pointe aiguë que la blessure protège.
Extraits de « Les Silencieuses », La Bartavelle éd.
**
Ponctualité de la distance
Demandeurs de gestes nouveaux
Visages de neige où des automnes s'éteignent. *
Les virgules non placées aux mains des feuilles rouges
Multiplient l'exigence ou l'écart
L'inconstance devient la tranquillité
La plainte et le vent *
Des murailles disparaissent dans leur propre écho.
Tant l'existence avec un reflet se confond
Et l'eau n'est pas où nous l'avons cherchée.
**
Libertés.
Une aubaine
A ne pas confondre avec un souffle court
Des initiatives germent
Il faut leur laisser le temps
De prendre la forme d'un banc
De se transformer en un rebond de cloche
Liberté
Suivre la formation d'un nuage
Et trouver la paix dans une absence de signes.
**
Quitter la main
Devenir l'ondulation du ruisseau
Correspondre à l'humeur du vent
Dans l'innocence du verger.
A bout de bras cueillir un mot
L'offrir sur un autel de lumière et de roses
Comme l'évidence du chemin.
Déposer les projections factices
Qui donnent d'inexactes représentations
Feux qui se brûlent eux-mêmes sans nous laisser de cendres
Des programmes de sel faussent les perspectives
Méfie-toi des bornes
Elles peuvent devenir les faiblesses de ton œil
**
Des gouttes de bruyères et de colchiques
Proposent les dimensions d'une saison perdue
Ecoute les tomber une à une
Dans un silence d'avant-garde
Et parfois si la chance est avec toi
Prends l'une d'elles.
A travers cette unité
Cristal hors des définitions
Découvre un autre aspect des choses.
Ainsi devrait être une âme
Si nous pouvions la conquérir.
**
Impératif d'attendre
D'une image brève à peine taillée
Dans la fugitive interrogation du vivant
Ne déplore pas la fuite rapide
Car le temps c'est toi qui le fixe
Il agit par rapport à tes indécisions
Et si tu l'entends sonner angélus des nuits prochaines
Félicite-toi de la précision de ton oreille.
Un berger des moutons des cols de contrebande
Le soleil reporte au lendemain
Des attestations de présence
Des ombres longues ouvrent
Un domaine privilégié de délires visuels
Où le buisson se mélange à la pierre.
Les mains le long du corps
Plaquées sur tes silences
De ton mystère retiens
Une équation d'ombre et de vent.
**
Dans le jardin
Le poète a cueilli ta sécheresse intense
Donne-lui la fontaine comme on donne un verre
Toi qui semble immobile.
Ton absence de gestes est une absence de vent
Epouvantail dont le doigt se pointe
Vers des heures incertaines.
Donne sans retenue
Même ce que tu ne possèdes pas
Par souci de conserver l'essentiel
Au-dessus des reflets narcissiques.
Donne par tes yeux vides
Donne par tes mains sans fin décisive
Tes leçons de soleil et d'espace.
**
Dans la nostalgie somptueuse du fleuve
Je cherche un vertige où les ponts de pierre
Deviennent une tendre éclosion
Reçue donnée par la lumière des berges
Et par les pas de tous les isolés.
Une renaissance écrite en lettres bleues
Sur les candides printemps de la mémoire
Qui se nourrit de neige et de graines enfouies
Un parcours protégé dont les allers retours
Passent du soleil à l'ombre
Par une volonté si diffuse
Qu'elle s'oublie dans la brume des lampadaires.
Les murs gris de la ville se referment
Sur des sommeils d'enfants
Un dernier soleil illumine un ciel d'ouest
Où notre destin s'écrit au participe passé.
Extraits de « Dans l'illusion de l'aube », Cahiers Bleus, éditions Zurfluh
Tu poseras le bouquet
Au croisement des chemins
Le silence entre deux poussées du vent
Eparpillera ta présence
Et mélange de galets et de soyeuse incertitude
De l'ondulation des blés un bruit de mer naîtra.
Ne dérange pas l'ordonnance
D'une explosion colorée
Pose ton bouquet sans complaisance
Deviens un geste simple
Deviens l'épilobe la jonquille ou l'églantine.
Signes de vie de tes carrefours
Un calvaire une croix
Une simple pierre levée
Une borne quelconque où l'homme
A déposé quelques repères.
Ne cherche pas à comprendre l'éclatement des chemins
Ton bouquet n'est pas leur conséquence
Mais le nœud qui contient l'unité du vivant.
**
Rustiques
Du pain un simple pain de ferme
Sur la toile cirée d'une longue table
Ou le saucisson dont l'odeur aigrelette
Conduit au litre de vin à peine entamé.
Des ensembles à portée de la main
Un regard de chat surpris dans l'infini des paupières
Un couteau la cuillère
Un bol une horloge et le village
Qui referme ses volets avec la précision
Que l'on attend des gens d'ici.
Un angélus clairière du temps vivant
Coule avec de petites secousses
Le long des pentes jusqu'au ruisseau
Jusqu'au geste achevé qui le récompense d'être.
**
Un cœur simple une bruyère au poing
Signe d'automne où les sources se taisent
Dans l'attente des neiges.
Moisson faite les terres s'allongent
Les vergers ont perdu leur raison d'être
La longue litanie des brumes échappe au passage
Des soins d'aube
L'incertaine proposition du colchique
Noue la ceinture des saisons insaisissables.
Votre soyeuse exactitude ô vol de mes hirondelles
Découpe au pochoir des symboles
Une syntaxe d'automne cherche ses mots fanés.
Bientôt dans la fluidité calendaire
Qui fixe Noël au coin du feu
Il faudra parcourir l'hiver
A pas d'ombre et de vent
Et frapper d'un doigt précis à l'angle des portes closes.
**
Infraction du réel
Nullement égaré sur l'évidence des choses
Source et parfois aboutissement
L'objet
Tel qu'en lui-même un rêve l'a défini.
Porteur de l'attention de l'homme
A la jonction de nos certitudes
Par la volonté fructueuse
Par le silence et par le mot fontaine
Qui coule dans le désert du non dit.
Levier des forces irrespectueuses
Au bout du geste comme un éclair
Doublant la mise
Incarnant la prescience de l'ouvrier
Dans la rigidité de l'acier
Et la souplesse relative des bois choisis
Aux temps de lune.
Désir et nécessité
Vivant de la vie des autres
Fleur et fruit de la matière
Négligeant les contingences
Pour devenir une étoile au pied d'un établi.
Extraits de « D'ombre et de vent », inédits
LE CHEVAL
Une nouvelle de Pierre Gabriel
En 1980, Pierre Gabriel m'avait confié cette nouvelle pour le premier numéro de Texture. Elle était inédite et, à ma connaissance, n'a pas été republiée depuis.
Lire le dossier Pierre Gabriel en cliquant ici
Le Cheval
Il est revenu, cette nuit encore. J'ai entendu son galop rôder longtemps autour de moi. Puis il a disparu du côté du verger. Comme la veille. Comme les autres fois.
Je ne sais depuis combien de temps se répète ce manège. Au début, je croyais à quelque farce d'un voisin venu caracoler sous mes fenêtres. Mais aucun d'eux ne possède de cheval. D'ailleurs, nul cavalier ne monte celui-ci.
Je l'ai vu, derrière mes volets. Je le vois tous les soirs tourner autour de la maison. Dès que j'entends s'annoncer son galop, un sentiment étrange m'envahit, où je démêle à la fois l'attirance et la crainte. Je guette son passage. Le voici ! Je me penche un peu plus pour entrevoir encore sa robe sombre, son poitrail de lutteur, sa silhouette souveraine.
Une fois, je suis sorti. Je me suis mis en travers de sa route. Non pour tenter de l'arrêter, mais pour savoir enfin à quoi ressemblait de plus près mon visiteur nocturne. Tout à coup, je l'ai senti fondre sur moi. Une énorme masse de chair et d'os qui, pas un instant, ne déviait de sa course. Je me suis jeté de côté. Sa crinière et sa queue m'ont fouetté au passage. J'ai pu voir tout contre mon visage son front taché de blanc, ses dents prêtes à mordre, l'éclat de ses yeux fous.
Je me suis renseigné au village et dans les fermes d'alentour. Mais nul cheval égaré n'y a été signalé. D'où sort donc celui- ci ? D'une caravane de romanichels, comme il en passe parfois à l'époque des vendanges ? D'un cirque peut être ? On n'a rien vu de tout cela depuis bientôt un an... J'ai senti que mon insistance intriguait les gens. On me jetait un drôle de regard. C'est tout juste si on ne me riait pas au nez ! Pourtant ce cheval existe. Chaque nuit je l'entends, je le vois.
Je passe mes journées à battre la campagne, à explorer les bois, les granges abandonnées, sans dénicher le moindre signe. J'ignore d'où il vient. Par contre, c'est toujours du côté du verger qu'il semble disparaître. De là, une allée de peupliers descend vers la rivière. J'ai scruté, je crois bien, chaque motte de talus, chaque pouce du chemin. Pas la plus légère empreinte de fer ou de sabot. De plus, la rivière, travaillée de remous redoutables, demeure infranchissable à cet endroit.
Alors, je ne comprends plus. Il me faut bien admettre que quelque chose d'insensé, de fabuleux peut être, vient de faire irruption dans ma vie. Ce qui m'arrive me bouleverse. Rien ne m'y préparait. Dans la monotonie d'une existence que suffisaient jusqu'ici à colorer les travaux des saisons pourquoi cette intrusion, pourquoi, chaque nuit, ce cheval ? Surgi tout frémissant d'un monde où je n'ai nulle part, il m'impose pourtant sa déroutante, sa provocante réalité.
Ainsi, tous les soirs, je me poste à l'affût. Et au bout d'un moment, en effet, j'entends son galop s'arracher au silence. Le rythme se précise, son martèlement devient plus dur, plus haletant. Ca y est ! Il est passé en trombe sous ma fenêtre. C'est comme s'il avait jailli de la nuit même !
Je l'ai suivi des yeux jusqu'à l'angle de la maison. C'est une belle bête. Un animal libre et fier dont l'élégance m'émerveille. Sa puissance, sa fougue, chaque fois me surprennent. A la clarté de la lune, sous les reflets de sa robe, les muscles jouent superbement, s'accusent, puis s'effacent dans une sorte de halo. Une fleur pâle aux trois pétales inégaux orne son front. Sa tête haut dressée reste toujours marquée de la même expression d'arrogance et de cruauté.
Jamais il ne s'arrête sous ma fenêtre, jamais même il n'a semblé s'apercevoir que j'étais là, que je l'épiais. Cependant il m'a choisi, il a choisi ma maison. Que me veut-il ? Qui me l'envoie ? De quelle ruse, de quelle menace est-il le messager ? Je ne discerne pas encore ce que l'on attend de moi, mais chaque soir je suis présent au rendez-vous.
Plus rien n'a d'importance. Rien d'autre que cette apparition que je guette le cœur battant. S'il allait ne plus reparaître, décevoir un espoir devenu désormais plus nécessaire que le pain, me laisser seul sur cette terre, m'abandonner à mon insignifiance... Mais non, à l'heure dite, le voici. Il ne faillit jamais. Alors je ne me pose plus de questions. Une sorte d'exaltation sauvage me saisit, mes mains tremblent, des mots sans suite se bousculent à mes lèvres. Cet instant pour lequel durant tout le jour j'ai vécu, je le sens m'habiter, m'étreindre, me brûler avec une violence qui me confond. Pour fugitif, pour aberrant même qu'il soit, je l'éprouve comme un miracle, un signe à moi seul adressé, un appel impérieux auquel il faudra bien que je réponde avant que l'on s'impatiente.
L'invisible réseau se resserre. Chaque ronde en tisse la trame. Mais ce galop qui m'enferme dans ma propre nuit, je l'entendrai un soir décroître, s'arrêter. Le cheval m'attendra, piaffant et s'ébrouant dans l'ombre. Je saurai qu'il est temps. Et je m'avancerai vers ce regard enfin posé sur moi, désarmé devant lui comme un enfant arraché au sommeil et qui trébuche au seuil de la lumière, doutant s'il veille ou s'il poursuit toujours le songe qui le tourmentait.
Pierre Gabriel
Quelques poèmes de Gabriel Cousin
Dès la publication de l'Ordinaire Amour (1958), Gabriel Cousin surprenait lecteurs et critiques par les sujets et le ton de sa poésie. Préfaçant la réédition du recueil en 1982, Georges Mounin soulignait ce qu'avait eu pour lui d'étonnant et de novateur ce «poème du couple» attaché aux «émotions authentiques de la vraie vie à deux» : sa capacité d'intégrer des sujets esthétiquement inavouables, voire tabous en poésie, tels que l'accouchement sans douleur, les hiatus amoureux, le travail, les enfants qui grandissent, les deuils familiaux, etc. Claude Roy le rejoignait, notant qu'«il y a aussi des sentiments, des émotions modernes qui attendent que la poésie s'en empare et qu'un poète les dise», pour estimer que Cousin l'avait fait. Quant à l'écriture, manifestement «ouverte à tous» et directe, on ne put que constater qu'elle détonnait dans le formalisme ambiant. Cousin évoquait le quotidien - le sien et celui de ses proches - avec une force et une simplicité désarmantes.
En 1998 j'ai effectué pour Louis Dubost et le Dé Bleu éd. un choix de textes publié sous le titre de "Dérober le feu". Voici quelques poèmes extraits de ce recueil. On peut également consulter le dossier que Texture consacre à G. Cousin en cliquant ici.
LA GRANDE LIBRAIRIE
Après avoir hésité longtemps, j'avais choisi la plus grande pour être moins remarqué.
Jeune ouvrier, il m'avait fallu tant de courage pour oser entrer.
Comme un voleur, j'achetai mon premier livre au rayon des occasions.
Je dérobais le feu.
(1941)
LA JEUNE FILLE VIETNAMIENNE
Elle descend l'escalier d'un jardin.
Hier soir son ami est parti. Il est aussi jeune qu'elle. Il doit marcher dans la forêt, son barda sur la tête, l'oreille collée à la liberté.
Elle va. Déjà elle entend, comme des clochettes, les voix des enfants allongés sous les arbres, car l'école a été bombardée. Elle parlera aujourd'hui de la poésie française.
Quand les Français ne tueront plus, son ami reviendra parmi les fleurs.
Elle ne voit plus les fleurs, elle n'entend plus les enfants. Elle est lui. Elle l'aide à marcher, elle l'aide à souffrir, elle l'aide à revenir.
(Mai 1952)
LA NAISSANCE
Trois fois trois jours la cloche des douleurs t'éveilla et ton visage prit la couleur qui m'avertissait. Toute ta chair se hâtait vers ce dernier travail.
L'éternel miracle était encore une fois à notre porte.
La grande poussée victorieuse libéra le poisson tout luisant de sa mère. Il était là, dangereux à tenir, et nous ne savions pas s'il était déjà lui ou encore nous.
C'est alors que nos yeux se reconnurent. Nous échangeâmes nos joies d'avoir mené la tâche, nos vigueurs d'avoir résisté à d'autres tentations, nos confiances de nous connaître.
Notre poisson restait là, endormi, après le grand effort de ses poumons et nous ne savions pas encore si son âme était arrivée.
LES NOYÉS DE LA SEINE
Au pied du Louvre
sous la Tour Eiffel
contre les usines Renault
le long des vins de Bercy
C'est là, chez nous, qu'ils passent.
Ils passent
le crâne défoncé
le ventre ouvert
les orbites vides
ou les pieds brûlés
Ils passent au fil de l'eau.
Autrefois, aux mêmes endroits
d'autres noyés passaient.
Ils portaient inscrit sur la poitrine
« Laissez passer la justice du Roi ! »
Aujourd'hui rien n'est inscrit.
Ils passent dans l'eau de notre Seine.
Quel le justice laissons-nous donc passer ?
Octobre 1961
LA CHALEUR DE SON CORPS
Je rêvais appuyé sur une table, lorsqu'elle vint par derrière et me prit dans ses bras.
La chaleur de son ventre sur mes reins, le moelleux de ses seins contre mon dos, le désir de ses mains sur ma poitrine m'envahirent.
Son souffle s'effilait sur ma nuque. Son cœur résonnait et se confondait avec le mien.
Nos corps devinrent vivants.
Bien plus tard, alors que le travail me harcelait, que la ville me piégeait et que la fatigue s'épanouissait comme une ivresse, je sentais encore son corps moulé au mien.
Cela me réchauffait sous la pluie comme un soleil posé sur mon dos.
JE MANGEAIS PRÈS DE MON FILS
C'était dans les premiers temps.
Sa présence physique m'était encore sensible. Son corps blond n'était pas entièrement mort pour le mien.
Et je venais souvent le midi.
Je m'asseyais à côté de la tombe, dans l'herbe, laissant mes yeux errer sur la splendeur des montagnes qu'il ne verrait jamais.
Je sortais le pain et mangeais à côté de mon fils, en copain.
Parfois des pas approchaient et je cachais les tartines, comme un voleur.
Ils n'auraient pas compris que l'on mange dans un cimetière.
MA FILLE A QUINZE ANS
Un matin la vie me surprit.
Un jeune pas de hauts talons.
L'instant d'une porte où de somptueuses jambes se gainent.
Cette nuque de jeune femme, torsadée de châtaignes rousses, qui s'incline.
Lueur d'une élégante robe rouge.
Acharnement de ce visage à discuter de Dieu, de l'amour, du bonheur.
Des mains fines dont les longs ongles portent des éclairs.
Cette voix inconnue de jeune fille dans la maison.
Ma fille a quinze ans.
CONSCIENCE
Il y a parfois comme de grandes choses achevées.
La table est rangée, la chambre propre. Tout est calme, paré de quiétude. Il n'y a plus que des amis. Plus besoin d'attitudes.
Les objets se regardent exister. Il semble que tout soit prêt, que le repos arrive.
La paix a la couleur du soleil. On peut désirer le sommeil. Mettre des fleurs dans les vases et comprendre les mots. Les livres sont des robes de jeunes filles.
Tout est simple et frais. L'amour, le travail et le corps. Les songes ont le temps de vivre.
Des nappes sereines entourent les épaules. Des buées rémittentes se posent sur le front. Le sang rêve. Les mains s'adoucissent.
Une perception universelle aiguise la conscience.
LES ENFANTS DE MES AMIS
Je sais des maisons que rien n'indique.
Closes sur un piano, ou bien ouvertes sur des jardins, ou encore perdues dans des collines, noyées dans les bruits des grandes cités.
Je sais qui ouvrira la porte. J'entends quel rire m'invitera, quelle voix dans le couloir m'accueillera. Je vois quel geste me fera signe.
Je reconnaîtrai les mains de mes amis, les yeux de mes camarades, la marche de mes copains.
Ainsi, je vous retrouve rajeunis, transposés dans ces joyeux corps dressés vers le soleil, dans ces esprits tournés vers les nourritures.
Mais j'ignore quel adolescent ou quelle adolescente, demeuré un peu dans l'ombre, me sourira comme la première femme, tendra la main comme le premier homme.
Ces poèmes extraits de divers recueils
sont tous inclus dans l'anthologie « Dérober le feu »
publiée au Dé Bleu et encore disponible
Pour consulter de Dossier G. Cousin, cliquer ici.
Le chant sans fin
Ce jour,
là,
comme aventure légère à travers le temps
qui me permettrait de cueillir
dire un nom
de fortune
d'atomes clairs
un nom qui voyagerait vers la vie
serait l'élan de la forme
un féminin dont on serait sûr
tes jupes douces dis-tu
le chant sans fin
sans alarme
où vivre serait simplement parcourir le lieu simple
nos jeudis de l'éternité
pour l'amour nécessaire.
31 janvier-2 février 2009
Ainsi de suite
à pouvoir chanter
la toute-femme
sur l'horizon
brillant le ciel
O verdure
pluie de soleil
de dire
branche à travers
oui sans relâche
Aller très loin
jusqu'où la vie
peut aller
où d'anciens animaux
croiseraient le hasard
les grandes forces bruyantes
Comment s'appelle l'avenue ?
voir le hasard sourire
et d'amitié-d'amour
avec nature entrer
en compagnonnage.
25 février-9 mars 2009
VALENTIN 36
L'Histoire commençait
On parlait de grand soir
le soir immense
de Chagall
O mérite du bleu
Pop sous sa veste rit
et de ses grosses mains
empoigne le travail
qui se dérobe
La chanson sur le lac
et le pain que je veux
le voyage
Demain
oui, là,
légère
désirable
celle dont l'ondée fine
viendra fruitière
ouvrir le sas
chasser les sempiternelles
Jardin
dont je veux les pétales
les couleurs agitées du vent
les odeurs pâles féminines
Présent alors intenable
partout faisant le chemin
Réel de face
debout comme jamais
depuis que les sources ont jailli
que l'homme des parois s'illustre
que la femme s'enfièvre
de tous ses fruits
Mon Adora
dit Picasso
ma sente
mon odalisque
monde humide des profondeurs
couvre le temps des villes pauvres
de ceux qui n'ont qu'un abri
Ici la grâce inaccomplie du doigt
se pose sur la faille
dans l'abandon des plis
de la rose secrète
et la jupe est fendue
La Poésie se dresse
et de ses mots soulève
chante femme et bien plus
Vers l'avenir s'étend
un brouillard tendre
Femme se penche
nue.
7-16 février 2009
Implosion
Une nouvelle de Michel Baglin
publiée dans "Toulouse sang dessus dessous" (Loubatières éd. 2001)
Toulouse, vendredi 21 décembre, 10 heures 17. Une explosion vient de souffler le complexe chimique, que tout le monde ici appelle encore « l'Onia », au sud de la ville.
Terrifiante.
Au fil des heures, on apprend que les morts se comptent par dizaines, les blessés par centaines, les sinistrés par milliers.
Un nuage ocre s'étire sur l'agglomération.
Les Toulousains, abasourdis, semblent ne pas parvenir à réaliser : vient de se produire ce qu'ils redoutaient depuis des décennies, ce que des générations avaient prédit sans être vraiment prises au sérieux.
Le quotidien régional sort une édition spéciale titrée « Le Drame ». Le lendemain, ce sera « L'horreur » : on aura pris la mesure de la catastrophe.
Puis les titres se déclinent les jours suivants : « Le traumatisme », « Le scandale » et enfin « La colère ». Entre temps, l'enquête a avancé, le débat s'est ouvert et l'hypothèse de l'accident, en dépit des rumeurs plus ou moins entretenues - il y a dix jours à peine que le monde a été bouleversé par les attentats aux États-Unis - est apparue la plus plausible. Mais on parle aussi d'une « poubelle chimique », d'une « usine dépotoir », mettant du même coup en accusation l'entreprise, sa direction et son propriétaire, Total, ce qui n'est évidemment pas du goût de tout le monde.
Je ne suis pas touché mais des amis le sont. Dans leur chair, leur tête ou leurs biens - dans ce qui constitue leur intimité, en tout cas. Beaucoup quittent leur maison, leur appartement dévastés. Avec l'idée de ne jamais y revenir, même si le complexe chimique doit définitivement fermer. On les aide à emporter ce qui reste, à tourner la page. Et c'est incroyable le nombre de gens qui ont décidé de « tourner la page ».
 Parmi eux, des écrivains en colère. Qui voudraient dénoncer, comme certains le font déjà depuis des années, la présence d'une bombe dans la ville, la logique économique qui engendre l'insécurité et le mépris des personnes. L'idée d'un livre fait son chemin. On m'invite à y participer. J'hésite, comme d'autres. Retenu sans doute, comme d'autres qui n'ont pas été aux premières loges, par cette sorte de pudeur qui nous a interdit pendant plusieurs jours d'aller voir de trop près la zone touchée, de se faire « voyeurs ». Il le fallait pourtant. Aucun récit, aucune photo, aucune des images dont la TV nous a abreuvés ne peuvent rendre compte de cette étendue de gravats, de toits éventrés, de vitres crevées, de façades aux volets pantelants. Je suis passé sur la rocade qui surplombe ce désastre : je n'ai pas reconnu ma ville. Et j'ai ardemment désiré que tous les Toulousains voient ça - ce qu'on leur avait fait.
Parmi eux, des écrivains en colère. Qui voudraient dénoncer, comme certains le font déjà depuis des années, la présence d'une bombe dans la ville, la logique économique qui engendre l'insécurité et le mépris des personnes. L'idée d'un livre fait son chemin. On m'invite à y participer. J'hésite, comme d'autres. Retenu sans doute, comme d'autres qui n'ont pas été aux premières loges, par cette sorte de pudeur qui nous a interdit pendant plusieurs jours d'aller voir de trop près la zone touchée, de se faire « voyeurs ». Il le fallait pourtant. Aucun récit, aucune photo, aucune des images dont la TV nous a abreuvés ne peuvent rendre compte de cette étendue de gravats, de toits éventrés, de vitres crevées, de façades aux volets pantelants. Je suis passé sur la rocade qui surplombe ce désastre : je n'ai pas reconnu ma ville. Et j'ai ardemment désiré que tous les Toulousains voient ça - ce qu'on leur avait fait.
J'ai donc fini par comprendre qu'il fallait essayer. Écrire, comme toujours, pour y voir peut-être plus clair... La nouvelle a paru dans un recueil collectif. Je l'avais située dans le futur et l'avais construite autour d'un personnage qui était de retour dans la ville de son enfance, après bien des années d'absence.
***
Ça lui fait drôle, bien sûr : il y a presque dix ans, depuis la mort de son père, qu'il n'est pas monté là, dans ce grenier. Il y a même encore un vieux calendrier qui traîne sur un tas de planches : 2001. L'année où ses parents avaient quitté la ville.
Il n'est pas venu pour ça, sans doute, mais pour la fuite sur le toit que lui ont signalée ses locataires. Pourtant, il reste là, comme stupide, devant tous ces objets oubliés dans ce coin de grenier que l'explosion n'avait pas dévasté jadis : une armoire déglinguée, un élément de cuisine et même un cadre de vélo. Et, dans un coin, appuyées les unes contre les autres, à moitié pourries et grises de poussière, des portes fenêtres aux vitres crevées ou fendues, aux huisseries arrachées. Personne n'avait songé à s'en débarrasser depuis le temps ! Ni ses parents alors, ni lui plus tard, quand ils furent décédés, ni ses locataires. Presque seize ans qu'elles sont là ! Comme un témoignage. Pour soudain réveiller sa mémoire, lui sauter au visage.
Il n'a pas oublié. Surtout pas le bruit. Incroyablement sec.
Légèrement malade, il était ce jour-là resté chez ses grands-parents, qui vivaient encore. Dans une petite maison, au nord de Toulouse. L'explosion avait été terrible mais, à l'autre bout de l'agglomération, elle leur avait paru quand même assez lointaine. Il n'avait que douze ans, il se souvient pourtant du grand-père qui avait laissé tomber : «Bondiou, c'est la poudrerie ! » Il avait entendu ça durant toute son enfance, les Toulousains répétant qu'un jour « ça péterait ». Le grand-père avait poussé jusqu'au bout du jardin et mis sa main en visière pour inspecter l'horizon, vers le sud. Le nuage n'était pas encore visible, mais il se méfiait. Et puis la radio avait fini par parler d'une explosion non pas à la Poudrerie mais à côté, à AZF.
Le grand-père avait dit : « On va appeler tes parents. Faut qu'ils viennent ici. Si jamais y a une fuite, ils sont aux premières loges ! » Il ne savait pas encore que les lignes et les réseaux étaient saturés, qu'il serait impossible de téléphoner de toute la journée, et qu'on affirmerait bientôt que le colonel des pompiers lui-même avait dû monter sur le toit de la caserne pour localiser le panache de fumée et l'explosion.
Aux premières loges, ses parents l'avaient été en effet ! La villa qu'ils habitaient avait perdu une partie de son toit, ses plafonds, ses fenêtres - qui avaient traversé les pièces avec les boiseries. Une cloison s'était effondrée sur le lit. Ce spectacle de désolation, il ne l'avait découvert que deux ou trois jours plus tard, quand ils étaient venus chercher ce qu'ils pourraient sauver. Mais l'image de la bibliothèque renversée, de l'aquarium crevé, du lustre pantelant, des objets éparpillés, renversés, écrasés au milieu des débris de verre et de plâtre, il avait su qu'elle ne s'effacerait jamais de sa mémoire.
Dans la salle de bain, sa mère avait été légèrement blessée par des éclats de verre. Elle était sortie de chez elle, le visage en sang. Quelqu'un l'avait fait monter dans une voiture, qui l'avait emmenée à l'hôpital.
L'usine de son père avait été peu touchée et il l'avait quittée aussitôt, en dépit des consignes de confinement diffusées par la radio. Il savait qu'il y avait du phosgène stocké sur le complexe chimique et l'odeur d'ammoniac qui envahissait les rues prouvait qu'un nuage, peut-être toxique, était en train de se répandre sur la ville. L'aéroport avait été fermé, les communications ferroviaires et routières interrompues, le scénario prévisible, et plus ou moins redouté par les autorités, se réalisait. Mais personne n'avait sérieusement envisagé une pareille explosion préalable, et c'est bien elle et son cortège de dégâts réels ou supposés qui occupaient tous les esprits, tandis que chacun s'empressait d'aller récupérer ses gosses à l'école ou de rejoindre ses proches, oubliant presque que le plus grand risque était celui de la pollution chimique.
Son père avait fait comme tout le monde, il s'était rué chez lui pour découvrir la maison dévastée et vide, du sang maculant le lavabo brisé de la salle de bain. Quelqu'un avait fini par lui indiquer qu'on avait emporté sa femme à l'hôpital et il l'avait enfin retrouvée, hébétée, en début d'après-midi. Mais ce n'est qu'en fin de journée, après avoir été bloqués plusieurs heures dans les embouteillages, qu'ils étaient arrivés chez les grands-parents. Et il se souvient qu'après avoir tenté d'expliquer, dans la plus grande confusion, ce qu'ils avaient vu et vécu, ils étaient restés longtemps silencieux, prostrés sur la canapé, tandis que les grands-parents s'évertuaient à les faire manger et à les réconforter du mieux qu'ils pouvaient.
Pourtant, dans ce grenier, soudain envahi par les souvenirs, ce qui lui revient avec le plus de force, et le bouleverse encore, ne concerne pas les événements de ce premier jour mais leurs conséquences plus lointaines, un épisode malheureux, peut-être anodin, et qui l'avait pourtant profondément meurtri.
Il s'était déroulé le dimanche de la semaine suivante. Presque dix jours s'étaient écoulés depuis la catastrophe et ils s'étaient installés chez les grands-parents. Son père avait quand même voulu « aller aux puces », comme il le faisait parfois, emmenant son fils dénicher des livres et de vieux illustrés à Saint-Sernin.
Ils n'avaient rien trouvé ce matin-là, le père n'avait pas vraiment la tête à chiner, ni d'ailleurs à rien d'autre depuis le jour de l'explosion. Comme beaucoup de Toulousains, comme lui-même qui n'avait qu'une jugeote de 12 ans, il éprouvait sans doute ce commun et insidieux malaise que rien ne semblait pouvoir dissiper. Ça vous laissait un peu flottant, irrésolu, presque incrédule. Ça ressemblait à du désarrois qui n'aurait pas voulu dire son nom. Ça collait à l'âme comme une vieille fatigue. Alors, devant ce vide qu'ils n'arrivaient pas à combler et qui faisait résonner même leurs rires d'une drôle de façon, ils s'étaient assis à la terrasse d'un café.
Il y avait là quelques hommes que son père connaissait plus ou moins et avec lesquels il s'était mis à parler. Lui n'écoutait pas. Pour tout dire, il était occupé à lorgner les jambes d'une jeune femme assise devant le comptoir. Elle avait un visage qui savait émouvoir sa puberté naissante, et plus encore une façon de croiser et de décroiser les jambes qui lui laissait entrevoir de vertigineux abîmes. Les gens qui entraient et sortaient du café la masquaient par intermittence et, bien qu'il eût légèrement déplacé sa chaise pour la mettre dans l'axe de la porte et du comptoir, il lui fallait rester vigilant pour ne rien perdre des rares et fugitifs instants où ses regards croyaient pouvoir percer un peu du mystère féminin. Il sentit pourtant que le ton de la discussion montait. On parlait bien sûr de « la catastrophe » et aussi, un peu, de l'attentat des États-Unis. Les tours du Word Trade Center s'étaient effondrées dix jours avant que « l' Onia » n'explose. Les deux événements, aussi incroyables que médiatisés, avaient durablement frappé les imaginations et ébranlé quelques certitudes. Au point de se mêler parfois, dans les consciences ou les inconscients, et d'éveiller une même et confuse révolte. Contre quelque chose de plus confus, de plus incertain encore.
Et c'était justement cela qui semblait envenimer la discussion. Un costaud, tout rouge, parlait d'attentat et de « racaille ». Son père, d'un ton de pédagogue, soutenait la thèse de l'accident. « Un accident, répétait-il, mais attention : pas innocent ! »
Un autre type, un petit, nerveux, lui coupait la parole. « C'est trop facile ! Ils nous cachent la vérité, on la saura jamais ! » Un troisième avait surenchéri : « Il y a des témoins qui ont vu une roquette tomber sur le dépôt. Elle venait du Mirail ! Pourquoi qu'on les interroge pas, ces témoins-là ? Parce que bien sûr, si c'est le Mirail, il faut rien dire !» Le Mirail, c'était évidemment le quartier à forte concentration de populations maghrébines...
Depuis plus d'une semaine, les rumeurs avaient colporté toute sorte d'hypothèses plus ou moins fantaisistes et il avait cent fois entendu son père pester « contre les imbéciles auxquels il faut absolument un bouc émissaire », ou ceux « qui se trompent toujours de colère ». Pendant le déjeuner, à plusieurs reprises, il s'était énervé tout seul. « Depuis l'attentat de Manhattan, martelait-il, certains ne pensent qu'à bouffer de l'Arabe. La thèse de l'accident les rend furieux. Ils sont frustrés de ne pas pouvoir déverser leur fiel ! »
Alors, bien sûr, ce matin-là, il ne s'étonna pas de voir son père, d'ordinaire plutôt réservé, voire timide, s'emporter en évacuant toute la tension accumulée depuis dix jours. D'autant que ses interlocuteurs faisaient front. « Vous êtes pas plus chimiste que moi, avec vos airs de professeur ! ironisait l'un des trois types. Mais les chimistes, eux, ils prétendent que le truc stocké...
- ...le nitrate d'ammonium...
- ... le nitrate machin si ça vous fait plaisir, ça saute pas tout seul !
- Lisez le journal : les conditions pour que le nitrate d'ammonium cesse d'être stable y sont expliquées. Apparemment, elles étaient réunies, et c'est ça le vrai scandale : les conditions du stockage ! »
Le rougeaud s'esclaffa : « Écoutez-le ! "Lisez-le journal"... Tu nous prends pour des cons, ma parole ! Tu t'imagines qu'on avale tout ce que racontent tes fouille-merde ? Tu voudrais nous faire croire qu'ils cherchent la vérité ?
- Si vous en doutez, pourquoi les appeler des fouille-merde ? »
Le rougeaud l'avait fixé avec des yeux vides, ne comprenant pas très bien où il voulait en venir.
Il se rappelle que son père avait essayé de se calmer, se voulant encore didactique. Et il l'avait trouvé, à ce moment-là, plutôt pathétique, son vieux. Il se souvenait parfaitement de ce qu'il avait dit. Que si des terroristes avaient dû faire sauter quelque chose, ils auraient probablement choisi un autre hangar que celui contenant un produit réputé stable. « Ils avaient l'embarras du choix ! » avait-il même essayé de plaisanter.
« Cause toujours ! » lui avait-on rétorqué.
Il avait encore voulu expliquer, nourri des articles de son quotidien favoris, que les expertises en balistique avaient localisé l'épicentre de l'explosion au cœur même du tas de nitrate, là où personne n'aurait pu introduire le moindre détonateur.
« Ben voyons ! »
Le petit nerveux tressautait sur sa chaise. Il éructa : « Et l'Algérien qu'on a retrouvé dans les décombres, qui portait trois slips sur lui, c'est pas la marque des kamikazes, ça, peut-être ? »
Lui avait encore essayé de lorgner du côté du comptoir et de la fille, mais ça devenait vraiment difficile de se concentrer ! « Vous êtes odieux, s'emportait son père. Ce type là est une victime, un malheureux qui s'est fait déchiqueter pour un travail et un salaire de merde ! »
Il se levait pour couper court quand le petit nerveux l'accrocha par la manche. « Partez pas, écoutez celle-là : j'ai un copain flic qui m'a dit qu'on a fait venir de Paris un inspecteur spécialisé dans les banlieues, c'est pas un signe, ça ? » Son père se contenta de hausser les épaules. « Laisse tomber, lâcha le costaud, Monsieur défend les bougnoules ! Il est du côté des Ben Laden et compagnie ! »
Du coup, le père s'était rassis en tapant sur la table. « Mais nom de Dieu, bande d'andouilles qui prétendez que le Mirail a fait sauter AZF, vous avez de la merde dans les yeux, ou quoi ? Vous y êtes allés, là-bas ? Aller y faire un tour, moi je le conseille à tout le monde, c'est presque un devoir ! Vous auriez vu que c'est exactement l'inverse qui s'est passé : c'est AZF qui a fait sauter le Mirail ! »
Encore un peu préoccupé par la dame du comptoir, lui n'avait pas vu le coup partir. Sans doute un coup d'épaule du costaud qui avait déstabilisé son père et failli le faire tomber de sa chaise. « Espèce de con, tu vas voir si on me traite d'andouille ! » Le rougeaud était resté assis, mais son père s'était levé, furieux, en même temps que le nerveux, qui était venu lui souffler son haleine sous le nez. Il avait repoussé le gringalet d'un geste brusque. L'autre, en reculant, avait heurté sa chaise, perdu l'équilibre et s'était retrouvé, fulminant, le cul par terre. C'est à ce moment que le costaud avait mis fin aux réjouissances en envoyant son poing dans la figure de son père. Assez fort pour le faire vaciller sur deux ou trois mètres, jusqu'à un arbre contre lequel il était resté appuyé un moment, le temps pour son fils de ramasser ses lunettes - fendues - et de lui glisser, tremblant : « Viens, papa, on s'en va... »
Le père, en rechaussant ses bésicles, s'était quand même rapproché de la table où deux types se marraient tandis que le troisième, le petit nerveux, essuyaient des égratignures sur sa joue. « Vous n'êtes que de tristes sires », leur avait-il dit posément. C'était tout son père, ça. Parce que même si c'était probablement vrai, le plus triste à ce moment-là, c'était quand même lui, son père, qui lui avait mis la main sur l'épaule en lui avouant : « Je suis navré de t'avoir fait assister à ça ».
Et puis ils avaient emprunté la rue du Taur pour rejoindre la place du Capitole. Son père avait laissé la main sur son épaule. Il penchait la tête, sans doute pour regarder quand même le spectacle du monde à travers les verres fendus de ses lunettes. Il avait sorti son mouchoir pour s'essuyer le nez, qui saignait un peu. Il avait même voulu plaisanter, mais ça sonnait faux. Et lui se taisait, parce qu'il se sentait terriblement impuissant et misérable devant ce père humilié.
Ils auraient pu en rester là, mais il y avait eu cet homme, à la terrasse d'un autre café, qui les avait hélés place du Capitole alors qu'ils se dirigeaient vers la bouche du métro. Son père le connaissait, c'était un cadre d'AZF affilié au même syndicat que lui. Et c'est probablement pour ça, dans l'espoir de trouver un peu de réconfort et de fraternité, qu'il avait accepté de s'attabler à nouveau devant un apéritif. Mais les choses, là encore, avaient failli mal tourner. Parce que l'autre sans doute culpabilisait et parce que son père était un incorrigible palabreur. « On nous accuse d'avoir mal fait notre boulot, se lamentait le syndicaliste. Même le journal...
- Je ne crois pas qu'on accuse les employés, avait voulu corriger son père. Tout le monde sait à quel point les effectifs avaient été réduits...
- Tout le monde veut fermer le complexe chimique ! s'entêtait l'autre. Et notre boulot ? Il va falloir en plus se battre pour sauver l'emploi !
- Il faut sauver les salaires, d'accord ! L'emploi, c'est autre chose. Il y a quand même des questions à se poser... »
Il aurait voulu partir, parce qu'il sentait bien que son père allait encore s'engager sur un terrain glissant. Il l'avait même un peu tiré par la manche. « Maman va s'inquiéter... » Mais c'était trop tard. Comme avec le grand-père quand ils étaient partis à se chamailler sur la politique. Dans ces cas-là, rien ne pouvait plus l'arrêter. Parce qu'il y mettait trop de cœur, son vieux. Et le voilà qui s'interrogeait sur ce qu'on fabriquait à l'Onia. Essentiellement des engrais pour l'agriculture intensive. La pollution des nappes ! Alors que dans les champs d'à côté on donnait des subventions pour la jachère ! C'était pas stupide, cette logique qui conduisait à la surproduction, à la faillite des petites exploitations, à la pourriture des sols et pour finir à l'explosion de Toulouse ? Il s'échauffait. S'emballait. Allait refaire le monde devant sa suze-ricard. Mais le compère n'en démordait pas : « Si on se bat pas pour l'emploi, nous syndicalistes, à quoi on sert ? » C'en était beaucoup trop pour ce matin-là. « Bon Dieu ! s'était emporté le père, mais avec ce raisonnement-là, tu pourrais même justifier les chambres à gaz : en fermant les camps, on a supprimé des emplois ! »
L'autre avait mis un certain temps avant de rétorquer : « Tu dis n'importe quoi, mon pauvre vieux... » Et c'était un peu vrai qu'il y allait fort, pour le coup, son père. Il ne comprenait pas grand chose à tout ça, mais il aurait bien aimé le lui dire. D'ailleurs, le père lui-même l'avait peut-être senti. Parce qu'il avait pris congé presque aussitôt, d'un air contrarié qui ne l'avait plus quitté jusqu'à la maison des grands-parents.
Et c'est cet après-midi là, alors qu'il était allé avec lui à la villa, pour déblayer encore une fois, ranger, mettre en cartons sans trop savoir par où commencer, c'est cet après-midi là, sous le toit crevé, alors que le jour déclinait, que pour la première fois de sa vie il avait vu son père se laisser tomber dans un fauteuil et, silencieusement, pleurer.
Il avait depuis souvent repensé à cette scène qui l'avait laissé interdit. Il avait alors fait semblant de ramasser des objets, de ne rien voir, en attendant que ça passe. Ça n'avait d'ailleurs pas duré longtemps. Mais le cœur à l'ouvrage n'y était plus et ils étaient repartis.
En redescendant du grenier, en quittant la maison qui n'avait été réparée que bien plus tard et qu'il avait choisi de louer à la mort de ses parents, il éprouve le besoin de marcher dans la rue qui l'a connu enfant. Il avance vers la route d'Espagne, passe sous le pont de la rocade et se trouve bientôt face à ce qui fut autrefois l'entrée d'AZF...
***
Je l'ai abandonné ici car, bien sûr, je ne pouvais savoir, en 2001, ce qu'il pourrait découvrir. On parlait alors d'un espace vert, d'un mémorial, d'un centre de traitement de compost - tout cela, juste après la catastrophe, quand les élus s'étaient soudain sentis la fibre écologiste. Mais, le temps passant, pouvait-on parier qu'ils auraient vraiment renoncé à ce fameux « sens des réalités » qui met depuis si longtemps la réalité à mal ? Levant les yeux sur ce qu'on aurait édifié là, n'allait-il pas découvrir un de ces complexes qui œuvrent, nous dit-on, pour l'emploi et le progrès du pouvoir d'achat et, accessoirement, la bonne humeur des actionnaires ? Une quelconque usine à produire non des objets utiles mais des dividendes, beaucoup de cette marge nette indispensable, paraît-il, aux démocraties modernes ? Levant les yeux, n'allait-il pas découvrir un complexe - bien sûr ultra sécurisé - fabriquant des mines antipersonnelles, par exemple, ces petites merveilles réservées à l'exportation, précieuses pour notre balance commerciale, et dont les pays du tiers-monde ont, semble-t-il, tellement besoin ?
Je l'ai abandonné là, redescendant du grenier et quittant la maison, en se remémorant la scène de son paternel meurtri. Il avait vieilli depuis, mis comme tout un chacun ses pas dans ceux de son père. Et sans doute compris que s'il avait pleuré ce jour-là, son vieux, ce n'était pas sur son sort. Ni même sur le malheur de ses voisins. Non, s'il avait pleuré, ce jour-là, le père, c'était bien de rage. De rage et d'impuissance, face à la bêtise qui s'acharne toujours à en remettre une couche.
Michel Baglin
Quelques poèmes
de Claude Saguet
Le poète toulousain Claude Saguet qui nous a quittés en septembre 2005, avait 69 ans. Discret, il avait peu publié - une dizaine de recueils - mais son écriture ramassée, d'une violence contenue, l'avait fait remarquer dès son premier recueil, L'œil déserté (1971, réédition en 1980 au Dé Bleu éd.). Lui ont succédé Xambo et les Barbares (1980), Terres de fièvres (1984), Le sud (1991), Distances (1992), Profils (1994), L'espace de la nuit.(1996).
Texture lui conscre un dossier qu'on peut lire en cliquant ici.
Voici également un choix de poèmes.

D'un trottoir à l'autre on perd un ami. L'aube tendue des grandes villes, la foule brusque, les rues le reconduisent toujours au premier rendez-vous ; lui confèrent une pureté devant quoi ne résistent ni le reflet de nos plaisirs, ni l'ombre de nos jours.
Pour avoir refusé d'aller avec le vent, combattu l'ombre jusqu'à la rage, ses fenêtres ouvrent sur l'exil. Mais lui ne veut se souvenir que de ce grand battement d'ailes ; que de cette bête fabuleuse que nous appelons Poésie et qui l'attend, pieds et cœur nus, sur une route de couteaux.
*
Poème, j'ai habité le Cri. Me reconnaîtras-tu tout bruissant de tes mots et debout dans leur force ? Amené toujours plus loin de la plus pure image, je me suis souvenu - les soirs de grand froid - des horizons battus en quête d'une luciole.
L'ombre était grise vers les bras, et toujours étrangère à l'alphabet de l'homme impatient d'une clarté à l'autre bout des choses.
Maintenant que la lumière change la couleur du ciel, que les sommets du cœur ne sont plus enneigés, me reconnaîtras-tu si je passe en silence dans la claire épaisseur d'un buisson de paroles ?
Poème, ce cri d'ailleurs et notre veille pour dire qu'il reste au plus large des années de nos longues fuites parallèles.
*
à Pablo Néruda
Il suffira
qu'une guitare se souvienne,
que l'ombre de nos cœurs
tourne comme un collier
pour qu'un chant sur le ciel
recommence le jour
soutenant tes racines
au nom de la lumière.
*
Poète,
la terre nous limite.
Et ce qui nous sépare
contribue à la nuit
qui disperse les chemins
pris à l'envers des arbres
et plus doux à connaître
qu'ils inventent l'espace.
(Extraits de Choix de poèmes. Texture, 1980.
Débris
Je porte en moi un cri d'usine
(et s'altère le sens du jour.)
Des trombes minutieuses,
l'égal d'une déroute.
Je porte aussi
un soleil vide,
les éperons du vent,
l'horizon du voyage.
Un nom, une ombre,
des voix froides,
Toute vie détruite à l'instant
Et qui savoure la mort
sur ma langue.
(Xambo ou les Barbares. Multiples,, 1980)
Il faudrait dire la ville
Limitée par ses murs,
Régie par les barrières
Que les ponts écartèlent
Et que la boue accable
De tout ce poids furieux
De maisons et de rues
Où je passe, feuille errante,
Plus secret qu'une cave.
A ma mère
Mon délire vient
d'un grand orage,
d'un lieu inexploré
à l'Est de l'Angoisse.
Tendresse verte aux carrefours
je le retrouve, couleur d'émeute,
en de lointains faubourgs
noyés de linges tristes.
Le soir peut faire la roue
quand j'écarte les branches,
ou vêtir de neige
la soif des oiseaux,
il assiège mes oreilles
plein de détonations.
En vain la mer efface
le bleu sourd du brouillard,
et griffe de ses sources
les filets de la pluie,
il balise d'injures
la nuit qui me ressemble.
Mon délire vient
de mille chaînes
coulées dans le regard
où tout se contredit.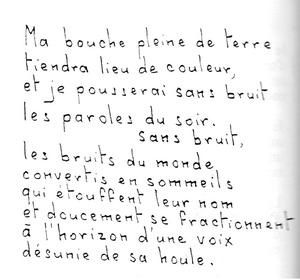
(Terre de fièvres éditions Tribu juin 1984)
Tu me parles,
je suis loin de toi.
Je te parle
et tu es loin de moi.
Et tu me comprends !
Séparés nous nous entendons.
Nous regardons l'un vers l'autre.
Ainsi
tes yeux qui passent
franchissent obstinément
ces rues interminables.
Ainsi
ton visage qui passe
lui aussi franchit les brumes :
ces denses haies de roseaux gris,
ce grand fleuve imaginable,
cette plane route en pointillés
devenue folle d'étendue.
J'effacerai ces distances inscrites
sur nous comme sur nos villes.
J'effacerai ces villes séparées.
Tu sais
cela demandera des siècles
Mais on aura la patience de l'aube,
la confiance des graines...
on aura tout le temps.
(Distances. Prix de l'Encrier. L'Ancrier. 1992.
Il n'aura pas de chant,
encore moins de musique.
Une voix d'homme assourdie
posera des questions,
ouvrira un passage
dans les années d'enfance.
Et ce bruit de paroles
aiguisées de hantises,
cette poussière d'échos
sur le tranchant des lèvres
traversera les bleus
de la maison secrète
triste comme ces lumières
appuyées sur la nuit
et qui ne savent pas,
une fois tuées les ombres,
l'espace à déchiffrer
pour mieux être nous-mêmes.
(L'Espace de la nuit. Le passe-Mots 1996)
Poèmes inédits
Midi campé
Dans sa blancheur compacte,
La ville regarde
Passer son ombre.
*
Agitée et tendue
Elle pousse au désordre
Et sa ruse consiste
A vider le regard.
*
Cette ville est une injure
qui s'inscrit dans les yeux,
une chose sauvage,
un combat de toujours.
Longue est sa course
Sans chaleur,
Fulgurante l'atmosphère
au soleil des fièvres.
Et on attend docile
écaillé de naufrages,
que le jour suspendu
au balcon du vertige,
tourmente la lumière
d'ombres inaccoutumées.
*
La ville se dresse au loin
ou s'étend prodigieuse.
Qu'une colère de couteaux
frange de froid sa lumière
ou dessine ses contours
embrumés de chaleur ;
la ville
- sans cesse éteinte,
sans cesse rallumée -
sait l'ombre de la veille,
l'heure qui nous reflète pour mieux nous envahir.
*
Nous marchons incertains
de nos regards rapides,
cherchant au fil des rues
un lointain souvenir.
Les trottoirs
soulignent nos pas ;
les vitrines se renvoient
de multiples visages,
et le soir qui ondule
sur cet ordre fragile,
déverse ses lumières
sans jamais s'essouffler.
*
Qu'ils se perdent dans les sables
aux lumières mouvantes
ou empruntent hésitants
d'imprécises distances,
les pas ajoutent aux pas
qui mènent autre part,
les gestes lents des morts
fleurissant notre exil.
*
Poètes,
j'aime ce que vous dites
du monde autour de nous,
de l'arbre où prendre appui.
Et parce que le printemps est un peu de cet air
traversé d'hirondelles descendues de la lune ;
parce que la solitude
ou bien un souvenir
se fabrique des mains
qui vibrent et vous reflètent ;
le jour vous laisse franchir
ses miroirs impassibles
et vous suivre brûlant
de vos métamorphoses.
*
Toute la terre
dans un éclat de siècle,
de racines mises à nu
ou serrées dans l'amour,
à grands pas
s'approche du poète :
ses mots courent en rafale
ou désignent tout bas
le souffle qui le porte.
Et les hommes qui l'accompagnent
après avoir longtemps erré,
vécu du rêve et du réel ;
tous en silence à cause des peines,
cherchant des signes,
des syllabes,
joignent leurs pas de loup
à sa voix d'ombre pure.
(Extraits de Lieux Majeurs. Inédits).
Pour lire le dossier consacré à Claude Saguet cliquer ici
Des poèmes que j'aime
Roland Nadaus
L'invention du Passé
L'invention du Passé commence avec notre amour : exister n'existe qu'au présent de toi.
Avant-toi est sans Histoire : dans le Pré-Cambrien de l'Enfance dans le Paléolithique du Baiser je n'étais qu'un fossile vivant.
On nomme cela « Préhistoire » moi je le nomme « Préhistoire de Toi » : quand tu parus le Passé prit soudain sens il partait de toi et menait à nous.
L'invention de l'Écriture
L'invention de l'Écriture date de l'invention de t'Aimer c'est prouvé : il y a des bêtes qui hurlent qui dansent ou qui puent pour s'attirer l'Autre - moi c'est en torchant des pages blanches que j'accomplis le rite : autour de moi en moi ça grouille de mots de sens de non-sens des sons encensent le silence et l'empuent comme mes phrases bavent leur encre à la manière des escargots - sur ta peau. Je suis un homme pariétal.
Même quand je n'étais pas encore moi - faute de toi - je crachais déjà l'ocre en sarbacane sur la roche ou bien j'y griffais à doigts nus la voix sans écrits de l'Amour. Toutes les grottes t'annoncent.
Toutes mes grottes témoignent de toi.
L'Invention de la Tendresse
L'invention de la Tendresse ne se date pas c'est comme celle de la Roue c'est comme celle de l'Enterrement des Morts - de toute façon depuis le Début nous sommes trop fatigués de porter tout seuls notre corps.
Et cependant tous deux nous voulions continuer de marcher ensemble et ensemble et plus loin encore - et pourquoi pas jusqu'à ces villages-mirages qui foutent l'horizon là où le Soleil est trop lourd pour les épaules de la Terre.
C'est ainsi que nous avons inventé Ce-qui-allège : on ne l'appelait pas encore Tendresse - mais c'était comme une roue d'amour : plus rien n'était lourd ni cruel et la mort s'enfuyait à tire d'Elle et nous étions immortels d'ainsi nous aimer.
Certains prétendent que Tendresse est le nom de cendres du Désir : pauvres fumeurs de Carbone 14 ! Décidément bien des animaux disparus en savent plus que vous sur l'Amour.
L'Invention de la Roue
Et puis un jour tu m'inventas la Roue - et marcher nous devint impossible : l'Amour roulait en nous sur nous entre nous contre nous tout autour de nous partout jusqu'au tournis jusqu'à l'ivrognerie nous nous roulions dans l'Amour.
Cerclés l'un à l'autre roue de feu au-dessus du Bourbier nous vivions un amour solaire - embrasés nous étions le Moyeu du Monde : c'est nous qui ordonnions le Jour et la Nuit. L'Univers tout entier ne tournait que parce que nous nous aimions en son centre immobile - comme nos sexes unis : nul va-et-vient sacrilège en ce Manège oh j'en ai vu des dieux jaloux de nous qui se frottaient en désordre pour une ombre d'étincelle !
Mais à la fin la Roue s'arrête qu'on croyait à jamais lancée : nous ne sommes plus des dieux - mais seulement des amants et encore : la Roue-Rosace n'est qu'un vitrail. Qui nous masquait l'Eternité.
L'Invention du Poème
Car le Poème s'invente mais ça n'est pas une invention : le Poème est une découverte qui existait déjà - on l'invente comme on « invente » un trésor.
Ainsi on invente des fleurs des fleuves des monts des insectes des îles - et qui sait : des mots ? - qui étaient déjà et bien avant nous - mais ils n'avaient pas d'existence avant qu'un homme les nomme.
Comme on s'invente l'Amour on invente le Poème qui l'accompagne qui l'accomplit le dit le chante jusqu'à l'épuisement jusqu'à la nuit de la nuit : c'était déjà comme ça quand nous étions préhistoriques et qu'on osait enterrer nos morts.
Mais maintenant ça change tout change : les poèmes coûtent trop cher en main d'œuvre - à part ceux de la Veuve Poignet et de ses clients.
« Au Lupanar Médiatique ».
Extraits de "Les Grandes Inventions de la préhistoire". Voir Notice
Jean-Noël Guéno
Je lis Malrieu
au jardin
dans la chaleur d'été,
soif épanchée
dans sa maison de feuillages
Frondaisons profondes
de la parole
Chant ruisselant
au midi
des hectares de soleil
Soudain les roses ploient
alanguies
sous le poids de l'été
offertes
au nom secret
de l'amour.
***
A notre éternelle jeunesse...
A vélo dans Nantes endormie.
Sac bistre : « Gardarem lo Larzac »,
s'y entassent les vertiges de Reverdy
saisis le matin même
au cours d'Yves Cosson, l'ami.
Sac jeté dans la sacoche
flanquée d'un « Sauver les bois,
les talus et les haies,
c'est aussi sauver l'homme ».
- Serait-ce si simple vraiment ? -
Je pédale à m'en décrocher
les jarrets
dans la nuit glaciale
amples cheveux au vent
qui me scie les reins
et la pulpe des doigts.
Quai de Versailles, au pont,
feu rouge.
Pied à terre.
A l'affiche « Les doigts dans la tête »
de Jacques Doillon.
Hasard ?
Je songe alors à vous
qui me ravitaillez
dans mes étapes au long cours
et m'aidez à tenir la route, debout,
malgré les coups de Jarnac
désespérés du passé.
Cœurs ouverts.
Dans nos mains le monde à changer.
Extrait de "L'Etoile pour la faim" Voir Notice
Aux amis Jean Rousselot et Lewigue, in memoriam.
(De retour de Paris dans le TER Nantes - Pornic)
Sur les vignes vieilles, le soleil décline les intimes variations du bonheur.
Un panneau, une vague aubette : un arrêt simple dans les prés.
Eaux, chênes, landes, chicots de brûlis, cendres dans le vent.
Fermes basses, usées, portes vermoulues encadrées de briques.
Rebord de fenêtre : chat docile qui guette l'arrivée de la nuit.
Les jardins livrent leur poids de secrets.
Une voix enregistrée, aseptisée, égrène la litanie complète des arrêts à venir.
Terres en friche, moulin sans ailes dans le squelette des arbres.
Auto rouillée, désossée, contre un talus chétif : abri déglingué des poules.
Cochons gras dans le sentier boueux des vaches.
Lourdeur de la terre, poids de l'heure immobile.
Le voyage dure une éternité. Le pays semble arrêté.
La nuit même attend, pour s'installer, on ne sait trop quel signe,
que n'oseront pas les voyageurs, indifférents.
Bourgneuf (-en-Retz), vieux bourg de Cadou.
Café « Au quai fleuri », sans la moindre fleur qui vaille.
La motrice meugle dans le soir.
Un ragondin péniche et tangue dans l'étier.
La mer, enfin, bleu tendre, aux Moutiers.
Orange, le disque, sur Noirmoutier,
double sur la vitre du train.
Avant Pornic, La Bernerie,
où vous vîntes, cher Jean Rousselot, le 5 décembre 1950,
visiter votre ami René Guy Cadou
avant son grand départ.
La vie n'est-elle donc que croisements, arrivées, départs
avec des haltes éphémères,
comme celle que nous vécûmes hier, à L'Etang-la-Ville,
avec notre ami Lewigue, peintre fulgurant, au geste large,
au regard vif et clair ?
Il nous faudrait cheminer au rythme
- immuable depuis les années 30 -
de ce train desservant, paisiblement, dans le soir,
les bourgs assoupis,
sans hâte d'arriver au terme,
seulement soucieux de vivre et de s'offrir
ces paroles qui sont en nous comme des perles.
Inédit
Monique Saint-Julia
J'écris des lettres, des lettres timbrées d'oiseaux, de coquillages de l'île de la Réunion, de tortues luth de Guyane, de coléoptères géants.
La terre est dans ma chair. J'y promène des forêts, des ombelles, des racines allongées hors de l'eau, des saules duveteux. Mois de lune noire, velouté des coulemelles. La cage d'oiseaux ruisselle de pépiements.
***
Je croise ces jours d'eau lasse, Toussaint d'ombres, longs nuages effleurant le ciel, regards s'enfonçant peu à peu vers l'obscurité du cœur.
Au loin, la mer creuse sa ride d'horizon.
Déjà viennent les portes entrebâillées des deuils, les mains et bustes penchés sur les tombes. Ciel amenuisé de gris, étang d'eau pieuse. C'est un voyage de tristesse, de sentes noyées, d'arbres défeuillés, quand les lèvres appellent des noms que la terre enferme dans son silence. Un souffle tiède remue les buissons. Plus les jours passent menant la fin des choses et des noms, plus le passé résonne. Détachés des muettes saisons, nous cheminons vers une lumière d'éternité.
***
Dernier jour de l'année. L'hiver est un abandon, un laisser-aller de couleurs, de haies, un dénuement de verger, de feuillages, d'odeurs. Il reste des cages d'oiseaux chantantes dans le bois, de longues flammes vertes et drues des genévriers remplis de petits fruits que l'on suce longuement.
Je voudrais parler de l'hiver dans la maison, des prés, des arbres, des buissons remplis de givre, dire des mots, comme des bulles lâchées par les truites, des mots aussi légers que des flocons.
Une voiture mortuaire fleurie passe : jardin botanique inondé de lys blancs, de violettes, de roses, de couronnes de pivoines.
Extraits de Claire-Voie (N&B ed.) Voir notice
René Char
La contre-terreur c'est ce vallon que peu à peu le brouillard comble, c'est le fugace bruissement des feuilles comme un essaim de fusées engourdies, c'est cette pesanteur bien répartie, c'est cette circulation ouatée d'animaux et d'insectes tirant mille traits sur l'écorce tendre de la nuit, c'est cette graine de luzerne sur la fossette d'un visage caressé, c'est cet incendie de la lune qui ne sera jamais un incendie, c'est un lendemain minuscule dont les intentions nous sont inconnues, c'est un buste aux couleurs vives qui s'est plié en souriant, c'est l'ombre, à quelques pas, d'un bref compagnon accroupi qui pense que le cuir de sa ceinture va céder... Qu'importent alors l'heure et le lieu où le diable nous a fixé rendez-vous !
Feuillets d'Hypnos
Marie-Claire Bancquart
Paroles de morts
Sous l'occupation de la vie, nous avions nos heures heureuses. Nous disions groseille à maquereau, pour que notre bouche s'emplisse d'acide, et nous disions profond amour pour y croire, le temps de dire. Il y avait des cueilleurs de jujubes, des successeurs de Couperin, des passionnés de timbres, des téléviseurs encastrés. On ne frappait pas toujours au grand portail, qui ne s'ouvre pas.
N'importe : libérés, on est mieux. On roule sans essence, on s'arrache les plaquettes de poèmes, on se tait comme des graines. Ces fêtes nous sont prêtées par nos successeurs. A leur tour sous l'occupation de la vie, c'est avec douceur qu'ils nous offrent (du fond de leur doute) leurs impossibles.
Extraits de "Rituel d'emportement"
Lucien Becker
Dès que tu entres dans ma chambre
tu la fais se tourner vers le soleil.
Le front sur toi de la plus faible lueur
et c'est tout le ciel qui t'enjambe.
Pour que mes mains puissent te toucher
il faut qu'elles se fraient un passage
à travers les blés dans lesquels tu te tiens,
avec toute une journée de pollen sur la bouche.
Nue, tu te jettes dans ma nudité
comme par une fenêtre
au-delà de laquelle le monde n'est plus
qu'une affiche qui se débat dans le vent.
Tu ne peux pas aller plus loin que mon corps
qui est contre toi comme un mur.
Tu fermes les yeux pour mieux suivre les chemins
que ma caresse trace sous ta peau.
Lucien Becker (Plein amour) Lire le dossier L. Becker
Jean Malrieu
Jean Malrieu (1915-1976) Lire le dossier Malrieu
Jean-Pierre Metge
Toujours exilé malgré moi ; toujours en partance. De mes pays du Sud je connaissais surtout les routes qui épousaient les paysages. Depuis peu sont éventrés les territoires de l'enfance, les virages sont laissés à l'oubli. Routes droites, routes communes, routes rapides : ne plus s'attarder au cœur de deuil des coquelicots.
Il reste heureusement des terres indomptables ; paysages karstiques aux calcaires imprimés de coquillages éternels, Causses où l'on peut errer encore jusqu'à perte de vue d'un muret gris à l'autre, à l'entour des dolines et des genévriers.
Plus au sud, j'habite d'autres paysages. Là, la campagne ne m'appartient plus : propriétés privées. En mes vers je parle prisons. Restent les cieux déjà océaniques mais jamais franchement d'azur.
En ce présent de paysans morts, éloigné du Lot, captif des banlieues toulousaines, je n'ai plus où marcher. Alors, par les mots, j'essaie de recréer mes Suds. Ils ont pour eux, mes Suds, la saute d'humeur de leurs vents, leurs nuages, leurs sécheresses, leurs noms de lieux qui rappellent la langue ancienne. Ils ne se veulent pas universels si l'universel c'est l'uniformité fade : ils se veulent uniques, riches de leur diversité pour demeurer universels.
Par mes poèmes je suis de leurs luttes déjà perdues d'avance, de leur mélancolie et si, comme eux, je suis triste au quotidien, nous avons au moins l'assurance d'être et pour cela, peut-être, d'être aimés.
A Chemise ouverte éd. 1994
Christian Da Silva
Poètes
Poètes, j'ai tiré votre nom de toutes les pages maudites
pour le mettre au grand jour des baladins,
au grand soleil des rocks et des ballades.
Vous étiez avec votre foie, vos camomilles
et vos braises qui ne touchaient plus terre.
Vous étiez sous les cuisses de l'albatros,
des plumes plein la bouche
et Baudelaire en deuil sous le manteau,
La Fontaine pissait encore en vos violons
pour des crincrins d'ascenseurs en sous-sol.
Poètes, j'ai tiré à bouts-mordants
sur vos étoiles tombées du nid,
sur vos cages dorées, sur vos colons malades
de déguster des cocktails-vermifuges.
A l'endroit même où votre peau affûte ses crayons,
je n'ai senti que de vieilles urines,
des vents sans forêts, des forêts sans arbres
et des arbres sans mains.
Vous avez cru que respirer signifiait la lumière
alors que l'essentiel vibrait sous des robes sans mots.
Vous avez cru qu'il suffisait d'attendre
la bénédiction des grands jésus imberbes
derrière leurs naphtalines.
Vous avez marché dans vos livres
avec des syllabes absentes
sans reconnaître les chemins et les rues.
Poètes, j'en ai marre d'être seul
avec vos squelettes sans herbes,
vos icônes qui se lèchent,
vos anges délabrés qui se gavent de morpions
pour se croire sexués,
votre air de ne voir, au-delà de la vitre,
que vos ombilics sans limbes
et vos pauvres haleines sans nuages.
Poètes, il a plu trop longtemps sur vos lignes,
les voici délavées.
Et ceux-là qui ne voient plus
fréquentent d'autres images.
Retroussez vos manches et vos bras,
les haches sont prêtes.
Poètes, je vous aime et vous sors
de vos carapaces inodores,
je vais vous mettre à poil sur la bascule
avant le grand combat.
Il est temps d'ouvrir les sarcophages
où se dorlotent vos bandelettes.
Les grands esprits vont crever, ils crèvent.
Poètes, je vous attends
derrière des mots d'hommes, des caresses de femmes,
des seins plus doux que la paresse d'être seins
des regards où l'enfance se met à en découdre.
Poètes, je vous aime et la chanson va mourir !
Il est temps de faire claquer vos langues sur un vin neuf
Il est temps de regarder en face
Ceux qui vous tournent le dos,
De les prendre à l'épaule et de crier :
J'ai des mots pour vous,
des parfums de mots, des épines de mots,
des minutes qui pressent.
Poètes, écrivez que le soir a des narines
pour accuser les odeurs
de n'être, trop souvent, que l'ombre des odeurs,
que les gens qui mâchonnent de vieux vers
n'ont rien d'autre à se mettre sous les chicots
et qu'il va bien falloir brûler leur mémoire,
envahir leurs draps sales pour les mettre debout,
face à l'évidente nécessité du poème,
celui qui dormait hier
et se mêlera bientôt à toutes ces mains molles
qui attendent sans savoir quoi...
Poètes, la nuit s'achève de vos lentes grossesses,
gueulez plus fort que les amplis,
mêlez-vous aux saisons, aux faubourgs, aux histoires,
conjurez les solitudes, voici le temps des clameurs,
hors des épaules courbées
hors des partouzes littéraires,
hors des fantômes suppliciés,
hors des miroirs où flirtent vos flanelles!
Poètes, je vous aime,
IL EST TEMPS !