
Yves Heurté, décédé en février 2006, était un écrivain prolixe qui a écrit dans tous les domaines : poésie, théâtre, romans, nouvelles et l'on trouve ses œuvres chez de multiples éditeurs, Gallimard, le Seuil, Milan, Castermann, Rougerie, etc. Le personnage, lui aussi, - médecin de montagne, humaniste engagé, voyageur et grand marcheur- était trés attachant. Je reprends ici quelques-uns des articles que j'avais publiés le concernant. En espérant qu'ils inciteront à le lire. Il le mérite amplement
Son premier livre fut un traité de self-défense, écrit à 18 ans, alors qu'il était objecteur de conscience (ce qui ne l'empêcha pas d'ailleurs d'obtenir la Croix de guerre après s'être engagé dans les brancardiers...) On l'aura compris, cet auteur-là n'avait rien de l'écrivain enfermé dans sa tour d'ivoire ! Il l'affirmait sans ambages : « Je suis fondamentalement un lyrique. Mais mon lyrisme est tourné vers les gens, non vers moi-même ». Un livre comme Voccero, long poème-cri d'une mère penchée sur la dépouille de son fils, démontre d'ailleurs avec force sa capacité à s'incarner en l'autre.
Mais revenons à Cierp, ce village proche de Saint-Béat et de Luchon, qu'il avait élu avec sa femme Madeleine, il y plus de cinquante ans. « Par souci écologique », disait-il laconiquement. Brièveté d'un pudique, qui dissimulait mal une grande passion pour la montagne et, notamment, les Pyrénées. Pour aller chez lui, on suivait la Pique, le torrent qui dévale de pierre en pierre a travers le village : il passe au fond de sa propriété. Sur le portail d'une belle demeure du XVII' siècle, une plaque « Yves Heurté, médecine générale ».
Car cet auteur-là fut aussi médecin de campagne à Cierp et dans la trentaine de communes des environs. Pendant presque quarante ans ! Certaines de ses visites, il les a faites à ski. Avec l'obligation parfois de dormir chez les patients, quand la neige bloquait les routes. On comprend qu'il ait pu affirmer : « Mon métier tire vers le social et mes thèmes, je les ai pris dans le quotidien des gens. C'est une source profonde d'inspiration ». Cette expérience, il l'a relatée à travers les beaux portraits de son livre, Gens de montagne.
La seconde de ses passion fut la marche. Ce Breton de pure souche, né en Champagne, grandi à Nantes, dans les Landes puis à Bordeaux, est allé attraper Dieu sait où le virus des sommets. Et il n'a pas cherché l'antidote. A tel point qu'il a passé son diplôme d'aspirant-guide de montagne - « un métier que j'aurais fait s'il n'y avait pas eu la médecine », avouait-il.
Ce virus, il l'a repassé à ses voisins, ses amis, qu'il a entraînés sur les flancs des Pyrénées et des Alpes. Accompagné de Madeleine, il part au Tibet. Avec sac à dos et porteurs, il s'embarque pour des semaines dans des marches à la Lanzman. Pour le « dépaysement philosophique », mais aussi, disait-il, parce que « marcher c'est aller au devant des gens. Les Tibétains sont encore plus passionnants que le Tibet ».
Et la littérature, dans tout ça ? On vient d'en traverser l'essentiel, la source d'inspiration, Le puits « heurtésien».
Mais pour en percevoir la tonalité et peut-être l'enjeu, revenons à la marche : « La fatigue physique amène ce qui est nécessaire à la poésie. Fourbu, on retourne à l'essentiel, à une certaine innocence... » Voilà l'auteur !
S'il a commencé par écrire des pièces après guerre, c est par un roman qu'il a vraiment débuté dans sa troisième passion (troisième, sans compter Madeleine, ses cinq enfants et celles que j'oublie comme la sculpture, la flûte et le jardinage).
« Le jour de mes 30 ans, j'ai réalisé que la médecine me dévorait et j'ai décidé de reprendre la plume ». Et ce sera La Nuque Raide, roman populiste sur les réfugiés espagnols irrédentistes du Val d'Aran, qui ne paraîtra qu'en 1975. Entre-temps, Gallimard aura publié La Ruche en feu, et sa première pièce, La nuit, les clowns aura été montée à l'Odéon.
Depuis, les livres se sont succédé, romans, récits, livres pour la jeunesse, recueils de poésie, contes et une vingtaine de pièces de théâtre, le rythme s'accélérant avec la retraite ! Mais l'inspiration était restée la même, puisée à deux grandes sources : le réalisme d'un côté, le symbolisme poétique de l'autre. Et en sautant d'un genre à l'autre, comme sur les pierres d'un torrent de l'Himalaya : « Quand j'ai fini une pièce, il faut que je passe au roman puis à la poésie... »
A croire qu'il prenait la plume comme le stéthoscope ou les chaussures de marche !
Michel Baglin
Quelques-uns de ses livres
Vous, gens de montagne
Auteur de nouvelles, de contes et de romans (chez Gallimard et au Seuil), poète (cinq recueils chez Rougerie), Yves Heurté a aussi beaucoup écrit pour le théâtre. Il nous a livré à travers des récits brefs, historiettes et souvenirs, des bribes autobiographiques. Tel fut le cas avec son Journal de nuit (éditions Alain Sutton) où il racontait Bordeaux sous l'Occupation et son adolescence. Il a récidivé avec Vous, gens de montagne, qui fait se succéder anecdotes et portraits sous une plume vive et souvent malicieuse.
Les « gens » dont il s'agit, Heurté les connaissait bien : cet auteur-là fut aussi médecin de campagne - pardon : de montagne - à Cierp, village proche de Saint-Béat et du val d'Aran, et dans les communes des environs. Pendant presque quarante ans !. Mais si on reconnaît ici l'écriture et les thèmes de l'auteur de fictions, Yves Heurté en redonnant vie à ses souvenirs n'a pas sacrifié à l'égotisme : il n'avait pas entrepris ses mémoires, mais ressuscité les femmes et les hommes qu'il a croisés à travers des histoires tragiques ou cocasses. « Dépassant souvent tout ce que romancier j'aurais eu peine à imaginer », confait-il.
Ce sont eux, leurs regards, leurs approches de la vie et leurs paroles qui donnent sens à ces pages. Les gens simples qu'il a soignés, écoutés, qui l'ont ému souvent et dont il a parfois beaucoup appris, sont ancrés moins dans un terroir que dans un espace un peu à part, celui de la montagne. Un espace qu'Heurté chérissait tout particulièrement. Car une autre de ses passions fut la marche. Il a aussi couru la montagne au devant de malades qui étaient les témoins d'une époque aujourd'hui quasi révolue : celle des bergers solitaires dans leurs cabanes sur les estives, des réfugiés espagnols qui avaient beaucoup à dire après avoir beaucoup donné... Mais ce qui reste d'actualité est ce qui fait le fonds de tous ces portraits, de toutes ces passions d'homme, de toutes ces histoires : le désarrois des êtres devant la maladie, les misères, la mort, et le pathétique de tout ce qu'ils inventent pour tenir bon, et tenir debout jusqu'à la fin.
Yves Heurté, qui savait le suggérer sans appuyer, avec une vraie compassion dissimulée sous l'humour, a sans doute écrit là un de ses meilleurs livres.
(Éditions De Borée. 270 pages. 18 euros)
Le Pas du loup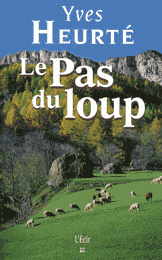
Après le volume, Vous, gens de montagne paru en 2004 un second, Le Pas du loup, posthume donc, fut publié par L'Ecir. On y retrouve, sous une plume vive et souvent malicieuse, les anecdotes et portraits qu'il a rapportés de près de 40 ans de pratique de la médecine de montagne.
Du vieux qui meurt de rire aux chasseurs de palombes partis en goguette, des histoires de colporteurs et de contrebandiers à celle du vieillard et de son âne privés de leur source, des histoires d'amour aussi émouvantes que sa "Lettre de Lucia" (un aveugle traverse à pied les Pyrénées pour saluer avant sa mort la femme qu'il a aimée jadis) jusqu'au dernier texte où l'écrivain se met en scène avec humour, on navigue ici du tragique au burlesque, du réalisme des "choses vues" au merveilleux de la parabole, à la limite parfois du fantastique. Mais toujours avec beaucoup de tendresse pour des personnages à la fois ordinaires et singuliers. Et une passion non dissimulée pour les Pyrénées, qu'Heurté célèbre ici.
(294 pages. 18_€. Editions L'Ecir.
158 av. Léon-Blum. 63000 Clermont-Ferrand)
Mémoire du mal
Le dernier recueil d'Yves Heurté, Mémoire du mal, fut publié en édition bilingue français-allemand par Rüdiger Fisher (également traducteur) aux éditions En Forêt (Verlag In Wald. Doenning 6. D93485 Rimbach. Allemagne).
Ce mal dont parle Heurté, même s'il a parfois des tonalités métaphysiques, est d'abord social et politique et renvoie aux charniers laissés par notre siècle finissant : « Notre nuit se partage / avec le couteau rouge / et flamboyant des guerres.» Y passent les ombres des martyrs des camps, des indiens victimes du génocide, des foules de chômeurs et de laissés pour compte de l'Occident « au seuil de sa nouvelle nuit ».
Poèmes sombres, bien sûr, pour ne pas oublier et ne pas refuser de voir aujourd'hui encore les épurations, les déportations et leur train, ils militent contre l'oubli et l'engourdissement : « O chers bons citoyens / consommateurs de riens, / passionnés d'inutile, / prenez garde qu'un jour / vous ne fassiez vous-mêmes / une ombre dans leurs trains.»
Poèmes qui opposent aussi l'homme à ses abstractions souvent meurtrières, car « le chanteur est plus grand / que le pays qu'il chante, / les amoureux que leurs amours.» Le poète, lui, n'a pas la tâche facile: « poètes à bout d'ailes / poètes à bout de mots / à bout de millénaire / nous reste à déchiffrer / un monde qui s'en fiche!»
(96 pages.)
Leçon de Ténèbres, une course poursuite sur le toit du monde
Yves Heurté connaissait bien le Tibet et c'est sur les hauts plateaux qu'il avait choisi d'entraîner son lecteur pour son troisième roman - et malgré un décor parfaitement planté dans sa « couleur locale », Il s'est éloigné du réalisme de ses précédents romans pour explorer l'âme du Tibet, ce pays où, dit-on, « une vérité qui change de plateau devient une histoire et, quand elle passe au désert, une légende. »
Son livre en a d'ailleurs l'allure, avec ce que la légende suppose de métaphysique et ce qu'une fable implique quant à sa construction : une histoire tout entière tendue vers sa conclusion (qui, ici, surprendra).
Tarki, le paysan, découvre sa fillette noyée dans un trou d'eau. On soupçonne vite Aïla, le moine borgne parti du village le matin même, de l'avoir tuée. Ivre de vengeance, Tarki se lance sur ses traces, une poignée de cheveux de sa fille dans sa besace. Commence alors une fabuleuse traque à travers le Tibet, les vallées, les villages et les déserts. Elle durera trente ans ! Le temps pour la haine de devenir mystique et pour la course-poursuite de se métamorphoser en quête.
Pour les deux hommes, qui passent par les mêmes épreuves, comme par les mêmes chemins, cette marche forcenée de trente années délivre sa « leçon » : le sens de leur vie s'est tout entier ramassé dans cette errance illuminée sur le toit du monde. Et quand Tarki rejoint finalement le moine, quand Aïla se laisse tuer, le vertige du vide saisit le chasseur, la fable se conclut par un retournement qui jette à nouveau Tarki sur les chemins de l'errance, dans la fuite.
Magistralement conduite par un auteur qui a le sens du tragique (les poèmes de Voccero comme son théâtre en témoignent), cette histoire sait aussi ménager de constants glissement entre le réalisme et la parabole - un aspect de l'art d'Yves Heurté, déjà sensible dans ses recueils de contes, mais qui trouve ici son accomplissement.
Le Phare de la Vieille
Yves Heurté a écrit également pour les jeunes. Après Le Passage du gitan (Gallimard), il a publié au Seuil-Jeunesse un roman d'aventures, Le Phare de la Vieille. Et après le Tibet des Chevaux de vent (Milan), l'écrivain-voyageur de Saint-Béat a emporté ses lecteurs sur les îles désolées de la Baltique, à la suite d'un journaliste en mal d'écriture, fasciné par les récits d'un vieux marin.
Son personnage est typé comme ceux d'un roman de Stevenson. De même sa femme, Fausta, au projet en effet diabolique de s'assurer, par une abondante correspondance avec les vieilles de la planète, un pouvoir sur le monde - et cela depuis le phare-refuge d'une île ravagée par la tempête. Goetz, le marin ivrogne et à demi fou, secrètement amoureux de Pili, la jeune écologiste, prétend contrecarrer les plans de sa terrible épouse, mais entraînera le journaliste dans sa propre démence au terme d'une histoire aux allures de fable. La mort, l'amour, l'âge, une violence sourde rôdent autour du phare de la Vieille, dans un roman auquel ne manquent aucun des ingrédients qui font voyager sous la lampe, dans le souffle des embruns et des légendes.
(Yves Heurté "Le Phare de la Vieille" Seuil-jeunesse 144p. 59F)
Au Bois sauvage
Autre roman pour la jeunesse : Au bois sauvage. Titou, le héros espiègle de ce recueil d'aventures quotidiennes et malicieuses, n'a pas plus froid aux yeux qu'il n'a la langue dans sa poche : il observe le monde et sait y placer son mot quand il faut. Il a surtout soif d'apprendre... la vie, et ne se prive pas de jouir de sa liberté dans une école (plutôt buissonnière) où les heures de classe dépendent du laitier, de la pluie, du vent ou de la sortie des premiers cèpes. De maraudes en apprentissage de la pêche, d'amitiés en petits deuils, de sous-bois complices en bords de rivière lumineux, c'est toute une enfance campagnarde qui s'offre aux jeunes lecteurs citadins. Une enfance révolue aussi car, on l'aura compris, la nostalgie irrigue secrètement toutes ces scènes du bonheur de vivre.
(Editions Sédrap. 192 pages.)
Un entretien avec Yves Heurté
Le poète, "un sauveur sans illusion"

Je ne tutoyais pas encore celui qui allait devenir un ami quand j'ai réalisé cet entretien avec Yves Heurté en 1985, pour le publier dans le numéro 23 de Texture (hiver-printemps 1986) que je lui ai consacré.
Roman, théâtre, poésie, nouvelle : vous avez touché à tout. Par quoi avez-vous commencé ?
Mon « art » a commencé en sifflant les merles dans les Landes. Puis j'ai soufflé dans une flûte traversière jusqu'au prix du conservatoire. J'ai dirigé des chorales et enfin joué en orchestre. Le tout sans écrire. C'est alors qu'une bande de copains m'a désigné comme écrivain patenté de la troupe. Adieu la musique, bonjour le suite... Mais en fait, du plus loin que je me souvienne, mon contact avec le monde fut poétique: un désir d'harmonie par le jeu. J'ai peu usé de la forme dite « poétique » ; j'avais trop besoin de « l'autre ». Le genre que je choisissais devait donc être public : romans et surtout théâtre. Je n'avais de ce fait presque aucun rapport avec les poètes à poèmes, et aucun avec le milieu dit « littéraire », ce qui ne simplifiait pas ma tâche. Je cherchais surtout les gens étranges ou étrangers, quitte à leur refaire par l'imaginaire un visage rêvé.
Pour échapper à ce monde occidental d'un urbanisme forcené fondé sur la violence, je choisissais la marche un peu partout. Ici et en Asie. Indes, Tibet, Nepal, Afghanistan, Pakistan, etc. Cette activité me semblait beaucoup plus poétique que l'écriture. En vérité, elle y menait. La défonce physique aide à se refaire une innocence, qui me semble le fondement même de la poésie.
Dans quelle écriture vous sentez-vous le plus à l'aise ?
Dans toutes et dans aucune. L'écriture est un petit moment de crise entre ce qui se met à remuer en moi et ce que je rêve de faire remuer chez l'autre.
 Votre poème dramatique, Voccero, me semble bien illustrer votre démarche. lyrique, mais sans retour sur soi. Un lyrisme de l'autre, en quelque sorte. Pour vous, le moi serait-il haïssable ?
Votre poème dramatique, Voccero, me semble bien illustrer votre démarche. lyrique, mais sans retour sur soi. Un lyrisme de l'autre, en quelque sorte. Pour vous, le moi serait-il haïssable ?
Si je ne me commémore pas, ce n'est pas par humilité, mais parce que j'aurais l'impression de. perdre mon temps. Par contre, commémorer le monde est une façon de l'amener à soi en même temps qu'on va à lui. Mais « haïssable », le moi ? Non, désolé, je m'aime bien.
Je voudrais aussi dire que l'attirail du corps est glorieux. Le crever sous un soleil de plomb, le plonger dans l'inquiétude des grands espaces ou dans un silence trop absolu, le sort des normes. Sans rancune, il me rend un surplus de vie. Ma poésie est donc plus sensuelle qu'intellectuelle, plus tournée vers le monde que lovée sur elle-même. S'arrêtant souvent pour se faire un clin d'œil. Là où rien n'est vraiment sérieux, tout peut se montrer tragique.
Vous attachez beaucoup d'importance à l'oral. Quelle est pour vous la finalité de la poésie: être lue ou être dite ?
Oui, ce que j'écris est fait pour être dit, et pas seulement mon théâtre. Je me revendique ainsi « homme du Sud » : partisan du dit chaud contre l'idée froide. Le Dit, signe d'échange. L'idée, signe de domination. L'image donne à choisir. L'idée tend, en notre temps, à s'affirmer comme idéologie, donc mise en forme du pouvoir.
Vous êtes donc partisan de l'image contre l'idée ?
D'une manière générale, je dirai que l'art manque de plus en plus d'innocence. Comme la flèche d'un arc trop tendu, trop d'intelligence fait manquer la cible de la beauté. Elle part dans la dérision. La poésie ne meurt pas, elle se perd.
Que pensez-vous de l'image aujourd'hui ?
Mode de communication privilégiée, elle se généralise, nous poursuit dans la rue et nous attend à la maison. Des jeunes, toujours plus nombreux, finissent par ne plus avoir recours au mot que pour la commenter. Et leur discours est d'une grande pauvreté. Que peut représenter la vieille métaphore poétique devant le déversement d'images des médias? Serait-elle insignifiante? Non, en réalité, c'est elle qui est signifiante. L'image médiatique nous montre la chose. L'image poétique est celle de l'être. La première, éphémère par nature, demande une consommation de plus en plus effrénée très proche de la toxicomanie. Elle ne comble le vide absurde qu'en l'exacerbant. La poésie et son imagerie mentale ne comblent pas un vide mais un besoin profond. Elle ne concerne pas des rapports de masses mais la communication avec soi-même sans cesse brisée par notre rythme de vie. Sa nécessité vitale se fera sentir de plus en plus.
Le personnage de la mère est très présent dans votre œuvre. Pourquoi ?
La poésie par nature est féminine, et le poète également. J'appelle nature féminine l'opposé de la nature technocratique, logique, agressive et intolérante, bref : notre monde sérieux et viril. La nature féminine, loin d'être illusion et rêverie, est lucidité. Il s'agit d'accepter et de louer l'homme tel qu'il est : contradictions insolubles suivies de questions insolubles. Soyons réalistes ! Supprimer le rêve de nos nuits conduit à un manque si important qu'il mène à des troubles mentaux sévères. Or nos songes ne s'embarrassent pas de concepts ni de dialectique, ils vont au plus important dans l'homme : la mythologie dans laquelle il se représente. L'art et notamment la poésie me semblent constituer un regard lucide sur nous-mêmes. Le rationalisme contemporain, par contre, se forge une image délirante de l'homme avec au bout - logiquement et non par on ne sait quelle malchance - des Staline, Hitler, Long Nol et autres terroristes ratiocinant...
Vous revenez, assez rapidement, aux problèmes de société... Est-ce cela, la modernité ?
On peut vouloir être moderne en jouant sur la permanence ou en optant pour l'éphémère. Certains ne jurent que par la griserie de l'éphémère. Pour eux, toute permanence semble d'un ridicule suranné. D'autres n'entendent se situer que dans « l'éternel de l'homme ». Dans cette attitude, seule est « éternelle » la peur du monde. En vérité, les hommes font ce qu'ils peuvent de leur nature avec leur temps. Les permanences dans l'éphémère, angoissantes et incertaines, sont les strapontins de la poésie de tous les temps.
Entre la permanence et l'éphémère, y a-t-il une place pour l'engagement ?
Une poésie peut être politique sans s'engager. Elle retrouve là sa dignité : être méprisée par toutes les idéologies. Les poètes ne changeront pas le monde. Les politiques ne changeront pas l'homme. Match nul. Il n'y aura pas de revanche...
D'ailleurs, la poésie est communication et non médiatisation des échanges. Elle n'aide pas deux êtres emmurés à s'observer de mur à mur. Elle est échange de «tuyaux » entre bricoleurs de l'âme.
Que pensez-vous de l'émotion et du lyrisme en poésie ?
La « sincérité du poète » ? Le torrent sentimental? Ce spontanéisme de concierge? Nous ne sommes pas plus sincères que le peintre ou le musicien. Comme l'acteur en scène, nous sommes des interprètes. Des rêveurs publics. A mon avis ce qu'on appelle le « sentiment » n'a d'ailleurs pas grand chose à voir avec le lyrisme, pas plus qu'avec l'élévation spirituelle religieuse. Le poète lyrique n'est pas l'homme par le petit bout. Sa sensibilité est sensuelle et son moteur tragique.
Vous êtes médecin de campagne. Votre profession a-t-elle influencé votre œuvre ?
Mon métier de médecin, dieu merci, en me forçant à me coltiner avec un réel incontournable, a avivé sans cesse ce conflit entre le monde et son image qui impose l'art comme solution aléatoire mais unique. Il me fournit en fait un ticket de premier balcon sur le monde... à condition, pour écrire, de laisser mon stéthoscope au vestiaire...

Une autre présence remarquable, dans votre œuvre, est celle de la montagne et, plus généralement, de la nature. Est-ce là le reflet d'attaches paysannes ?
Mais non ! Je ne suis pas campagnard ! Mon village vit d'une grosse usine d'électrométallurgie. J'écris devant la lueur des fours qui se reflètent sur le dos de vaches archaïques. Ma seule œuvre populiste est l'histoire d'un exilé espagnol, un marginal qui ne supporte pas la vie paysanne. Mais j'admets être aussi à l'aise dans une métropole qu'un violoniste dans un concasseur.
Je dois d'ailleurs dire que mon absence de la vie intellectuelle parisienne ne me hisse guère en littérature. Il est arrivé à un de mes textes d'atteindre des centaines de milliers de Français, Allemands, Bulgares, etc. sans récolter un seul mot dans la presse de notre capitale. Qu'y faire? Changer de vie ?
Justement, votre vie est bien remplie. Vous aimez les voyages, la montagne, l'écriture, votre métier. Qu'est-ce qui définit ou comble le mieux l'homme Heurté ?
Je me pardonne mon introversion foncière (si, si !) grâce à des petites aventures qui remettent tout en question. Galoper au Tibet, c'est courir le risque d'y crever. Soigner des gens, c'est courir le risque de risquer la peau de mes copains bipèdes. Écrire est risquer son âme.
Choix essentiels où je me sens bien. Tout choix déjà fait m'emmerde. Et si l'on me met devant le choix des risques? Je lâche ma feuille blanche pour la couverture pierreuse d'un glacier himalayen ou d'un volcan islandais. Que la poésie me courre après si ça lui chante... Mais il lui arrive de me rattraper...
Que lit Yves Heurté ?
On peut avoir le besoin d'écrire sans avoir celui de lire. Exiger d'être aimé sans aimer. Ma bible quasi quotidienne, c'est tout de même Saint John Perse. Par ailleurs, le n'ai malheureusement pas le temps de me cultiver. Mais je fais une exception pour la presse : l'image d'un monde mouvant me passionne.
Qu'est-ce qu'un poète en 1985 et à quoi sert-il ?
Un sauveur sans illusion. Et cependant, jamais société n'a eu autant besoin de ses poètes, cette société qui fonde ses pouvoirs sur la conviction lancinante et omniprésente de l'image médiatique, drogue destinée à faire passer un développement technologique et des idéologies irresponsables. Les questions essentielles de notre nature et de notre destinée ne pouvant plus être posées sont enfouies par la psychanalyse, la sociologie, etc. Il appartient aux artistes et en particulier aux poètes, dont les mots ont charge mythique naturelle, de les refaire surgir inlassablement.
Nietzsche, dont on ne peut suspecter le modernisme, disait : « L'art, nous n'avons plus que l'art pour nous aider à supporter la vérité ». Le conflit s'annonce inévitable entre les gens de Verbe et ceux qui voudraient nous enchiffrer pour nous rendre semblables, fonctionnels et soumis. Le nombre croissant des poètes emprisonnés, torturés ou «  disparus » sous tous les régimes témoigne de la nécessité de notre survie. Un monde sans poètes serait désespérément voué à l'ordinateur et aux sociétés implacables qui s'installent un peu partout.
disparus » sous tous les régimes témoigne de la nécessité de notre survie. Un monde sans poètes serait désespérément voué à l'ordinateur et aux sociétés implacables qui s'installent un peu partout.
Cela ne m'empêche pas de travailler sur une machine à mémoire qui permet le traitement de texte - même poétique l Ma poésie ne s'en porte pas plus mal, bien au contraire, mais elle domine ses moyens.
Propos recueillis par Michel Baglin
Image émouvante de deux amis disparus: Jean-Pierre Metge discute avec Yves Heurté. (Photo MB)
Bibliographie
Yves Heurté a une œuvre très abondante, d'une bonne cinquantaine de volumes. Parmi ceux-ci, on retiendra :
En poésie
Voccero, poème dramatique. Rougerie. 1975
Le Carnet tibétain, Rougerie. 1984
Passion, Sud. 1986
Bois de mer, Cheyne. 1986. (poèmes mis en musique et chantés par Martine Caplanne. CD, MSI Pour écouter deux chansons, cliquer ici
La Noce solitaire, Rougerie. 1987
Les Mers intérieures, Rougerie. 1992
Point d'orgue, Rougerie. 1994
Mémoire du Mal, Ed. En Forêt, 1998
Romans
La Ruche en feu, Gallimard, 1970
La Nuque raide, Entente, 1975
Leçon de ténèbres, Arcantère, 1988
Le Passage du Gitan, Gallimard, 1991
Les Chevaux de vent, Milan, 1995
Le Phare de la Vieille, Seuil, 1995
L'Horloger de l'aube, Syros, 1997
L'Atelier de la folie, Seuil, 1998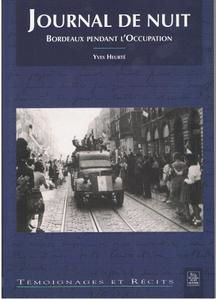
Récits et livres de souvenirs
Vous, gens de montagne, De Borée, 2004
Le Pas du Loup, L'ecir, 2006
Journal de nuit, journal de guerre d'un adolescent, éditions Alan Sutton, 2003
Yves Heurté a écrit plusieurs romans pour la jeunesse, ainsi que des contes et nouvelles, notamment chez Magnard.
Il a également écrit une dizaine de pièces publiées aux éditions Rougerie, ainsi que des textes pour la radio.
Une lettre-préface de René Rougerie
Pour le numéro 23 de Texture, j'avais demandé une lettre-préface à René Rougerie, qui est l'un des principaux - et des premiers - éditeurs d'Yves Heurté. La voici.
Cher Michel Baglin,
Vous m'avez demandé un texte de présentation sur Yves Heurté. J'ai quelques scrupules à l'écrire, m'étant imposé une règle de réserve.
J'ai dit à plusieurs reprises, et notamment en tête du numéro un de «Poésie présente», quelle poésie j'aimais. Mon catalogue indique lui aussi clairement mes goûts, même si certains noms que j'aurais aimé y inscrire n'y figurent pas. Aussi ai-je l'habitude de dire tout simplement: j'aime - sans donner une explication - je n'aime pas - alors là, oui, j'en donne les raisons.
Yves heurté? J'ignorais tout de lui lorsque Edmond Humeau me remit Voccero. C'était en 19 75. Déjà à cette époque j'avais regroupé une cinquantaine de poètes que~ je souhaitais éditer régulièrement et je ne pouvais que très difficilement envisager d'agrandir « l'équipe » (une équipe, pas une chapelle), l'éditeur (de poésie) devant rester un artisan. Toutefois, une porte restait - elle reste encore - entrouverte.
J'ai donc hésité à publier Voccero - le publier impliquant l'obligation morale de publier d'autres poèmes de la même veine... et du même auteur. Pourquoi finalement ai-je ouvert les pages de Poésie présente à Voccero... et à la suite ? Sans doute parce que cette poésie avait la densité, le poids des mots qui me sont chers. Mais aussi il y passait un souffle, une chaleur, et cette alliance est trop rare pour ne pas offrir une chance à son créateur.
Je sens trop souvent que la concision de la poésie que j'aime pourrait aboutir à une certaine froideur, à la page blanche même. Chez Heurté, rien de cela. Il y a une vie qui sait se faire entendre. Oui, une poésie qui vous parle au travers de la lecture; une longue suite de cris, de chant, d'amour.
Si la poésie doit nous permettre de découvrir, d'approcher les « réalités secrètes », pourquoi ne ferait-elle pas éclater cette réalité en une générosité du cœur: soigner, mais aussi donner la vie, au travers de diverses activités qui finalement n'en forment qu'une et façonnent à leur tour l'homme Heurté ?
L'homme Heurté, c'est aussi le médecin de campagne avec sa vie solide au pied de la montagne. J'ai eu la chance de le suivre à la tombée de la nuit dans des villages où se cachait la souffrance et c'est dans ce combat, entre la maladie et la mort, que nait pour lui une autre vie pour d'autres personnages.
Yves Heurté est romancier et homme de théâtre et poète. Le souffle du théâtre imprègne toute sa vie, parcourt sa poésie ; mais celle-ci ne tombe pas dans le piège de la représentation. Elle est authentique, sans concession. Je ne ferai pas de citation, cette poésie se coupe mal en tranches. Chaque recueil est un seul et même poème en plusieurs actes. Je souhaite que ce poème chante longtemps encore au travers des pages de votre revue et de nouveaux livres.
Je tiens à vous remercier d'avoir présenté dès poètes tels que Yves Heurté et auparavant Pierre Gabriel. Pour moi le Midi, c'est aussi Paul Pugnaud, Henry Cheyron, Jean Digot... il y en, a d'autres. Ils ont, avec leurs personnalités propres, quelque chose en commun, une richesse généreuse qu'ils offrent au travers de leur œuvre au lecteur. A celui-ci de ne pas l'ignorer. Des poètes à découvrir.- c'est le rôle que de petits éditeurs (et de jeunes revues) devraient avoir à cœur de jouer. Hélas, beaucoup essaient d'accrocher leur marque commerciale (hélas encore) à 1a renommée de poètes en vogue - ô combien précaire.
Merci à vous.
René Rougerie.
Lire aussi l'article de Georges Cathalo:
Écriture et médecine douces











 Max-Pol Fouchet a été inspiré par un séjour en Italie et par les tableaux que l'auteur, Jean-Luc Aribaud, a pu y admirer. Ce Toulousain a déjà publié quatre recueils et a reçu le prix Louis Guillaume, il est aussi photographe et expose à l'étranger comme en France. Ses poèmes pour la plupart ouvrent un dialogue avec la peinture (Le Titien, Cézanne, Gauguin, Picasso, Bacon, Chagall). C'est là une manière d'encore baigner dans la lumière, mais aussi de se confronter à l'obscurité et à l'épaisseur indéchiffrable du monde.
Max-Pol Fouchet a été inspiré par un séjour en Italie et par les tableaux que l'auteur, Jean-Luc Aribaud, a pu y admirer. Ce Toulousain a déjà publié quatre recueils et a reçu le prix Louis Guillaume, il est aussi photographe et expose à l'étranger comme en France. Ses poèmes pour la plupart ouvrent un dialogue avec la peinture (Le Titien, Cézanne, Gauguin, Picasso, Bacon, Chagall). C'est là une manière d'encore baigner dans la lumière, mais aussi de se confronter à l'obscurité et à l'épaisseur indéchiffrable du monde.
 ui vous manque / et parle à votre place ». La mort elle-même perd un peu de son tragique : « Je glisserais vers cette nuit natale / où l'âme habiterait la fraternelle voix / qui chantait à ma place en mémoire de moi. » Tant il est vrai que « nulle voix près de se taire ne renonce à sa lumière ».
ui vous manque / et parle à votre place ». La mort elle-même perd un peu de son tragique : « Je glisserais vers cette nuit natale / où l'âme habiterait la fraternelle voix / qui chantait à ma place en mémoire de moi. » Tant il est vrai que « nulle voix près de se taire ne renonce à sa lumière ».

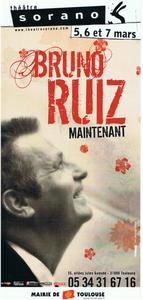
 « En accueillant Bruno Ruiz et Maurice Fanon, lou Becut recevait ce dernier week-end, une fois encore, la chanson de qualité. Bruno Ruiz, auteur compositeur interprète, a écrit plus de deux cents chansons et considère pourtant son travail avec modestie : il cherche la correspondance parfaite, la plus significative, entre texte et mélodie. L'image juste, celle qui, jamais conventionnelle, sait bousculer les sensibilités reçues et trouver un écho parmi l'auditoire. Pari difficile de la poésie. Mais à travers son « discours qui s'impatiente », Bruno Ruiz a de la colère et de l'émoi à revendre ou plutôt à donner. S'il ne s'ampute d'aucune part de lui-même, s'adressant à tous (aux « gens que je déçois de mes pantoufles maladroites », comme aux autres) pour avouer sa « peur de mourir avant la saveur des vieux jours » et renouer avec son « rêve écolier », il ne néglige rien et surtout pas l'humour qui est parfois, aussi, une manière de pudeur. »
« En accueillant Bruno Ruiz et Maurice Fanon, lou Becut recevait ce dernier week-end, une fois encore, la chanson de qualité. Bruno Ruiz, auteur compositeur interprète, a écrit plus de deux cents chansons et considère pourtant son travail avec modestie : il cherche la correspondance parfaite, la plus significative, entre texte et mélodie. L'image juste, celle qui, jamais conventionnelle, sait bousculer les sensibilités reçues et trouver un écho parmi l'auditoire. Pari difficile de la poésie. Mais à travers son « discours qui s'impatiente », Bruno Ruiz a de la colère et de l'émoi à revendre ou plutôt à donner. S'il ne s'ampute d'aucune part de lui-même, s'adressant à tous (aux « gens que je déçois de mes pantoufles maladroites », comme aux autres) pour avouer sa « peur de mourir avant la saveur des vieux jours » et renouer avec son « rêve écolier », il ne néglige rien et surtout pas l'humour qui est parfois, aussi, une manière de pudeur. »
 Mais à côté de ces sept disques et des centaines de concerts donnés ici et là, une vingtaine de livres jalonnent aussi le chemin poétique de Bruno Ruiz, pour l'essentiel des recueils de poèmes, à l'image de cette plaquette,
Mais à côté de ces sept disques et des centaines de concerts donnés ici et là, une vingtaine de livres jalonnent aussi le chemin poétique de Bruno Ruiz, pour l'essentiel des recueils de poèmes, à l'image de cette plaquette, 
 Georges Drano vient de faire paraître "les Feuilles du Figuier". Retour sur la vie et l'oeuvre de ce poète né en 1936 à Redon (35), qui a vécu en Bretagne jusqu'en 1993 et réside maintenant dans l'Hérault. Qui fut enseignant, organise et présente régulièrement des lectures publiques et participe à l'organisation de festivals de poésie (A la Santé des Poètes, les Voix de la Méditerranée). Et qui a obtenu le Prix de poésie Guy Lévis Mano en 1992.
Georges Drano vient de faire paraître "les Feuilles du Figuier". Retour sur la vie et l'oeuvre de ce poète né en 1936 à Redon (35), qui a vécu en Bretagne jusqu'en 1993 et réside maintenant dans l'Hérault. Qui fut enseignant, organise et présente régulièrement des lectures publiques et participe à l'organisation de festivals de poésie (A la Santé des Poètes, les Voix de la Méditerranée). Et qui a obtenu le Prix de poésie Guy Lévis Mano en 1992.





 Pourtant, son propos et son engagement ont du fond, les entretiens ici et là publiés (notamment dans le numéro de la collection « Fresque d'écrivain » des éditions du Soleil natal que lui consacre Michel Héroult) le prouvent. Tout comme son analyse aussi subtile qu'iconoclaste de la poésie de circonstance dans
Pourtant, son propos et son engagement ont du fond, les entretiens ici et là publiés (notamment dans le numéro de la collection « Fresque d'écrivain » des éditions du Soleil natal que lui consacre Michel Héroult) le prouvent. Tout comme son analyse aussi subtile qu'iconoclaste de la poésie de circonstance dans 

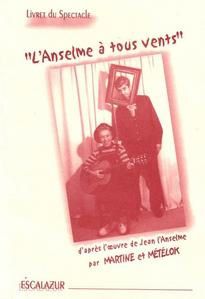



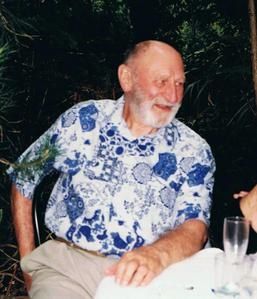



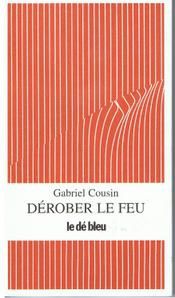





 gravité ni la réflexion, un formidable appétit des sensations et des corps, une ivresse renouvelée d'être au monde (« Le vertige se partage comme l'alcool », dit-il) sont le leitmotiv de ce journal qui est comme l'autre versant de son dernier recueil, en forme d'hymne à la jubilation des peaux et des cœurs, et de festin érotique, Nus jusqu'au cœur (La Bartavelle éd.). Il conduit la même quête d'amour solaire, de sens et de fusion avec l'autre, en faisant mentir le vers désespéré de Lucien Becker (« Tu ne peux pas aller plus loin que mon corps ») : il répète que l'amour et l'érotisme, qu'il faut toujours confondre, veulent justement qu'on s'abandonne à ce vertige d'aller plus loin, d'être homme de chair, d'inquiétude et de soif, éperdu de mots et de partage.
gravité ni la réflexion, un formidable appétit des sensations et des corps, une ivresse renouvelée d'être au monde (« Le vertige se partage comme l'alcool », dit-il) sont le leitmotiv de ce journal qui est comme l'autre versant de son dernier recueil, en forme d'hymne à la jubilation des peaux et des cœurs, et de festin érotique, Nus jusqu'au cœur (La Bartavelle éd.). Il conduit la même quête d'amour solaire, de sens et de fusion avec l'autre, en faisant mentir le vers désespéré de Lucien Becker (« Tu ne peux pas aller plus loin que mon corps ») : il répète que l'amour et l'érotisme, qu'il faut toujours confondre, veulent justement qu'on s'abandonne à ce vertige d'aller plus loin, d'être homme de chair, d'inquiétude et de soif, éperdu de mots et de partage.

